

Marion Pécher
Gaspard de la nuit, 3 poèmes pour piano de Maurice Ravel d'après Aloysius Bertrand
Ravel exorciste du romantisme : "Tous modernes !" Deux Ondines, deux démarches créatrices: Claude Debussy et Maurice Ravel Le Gibet et le Crépusculaire Scarbo : un romantisme digital « Poèmes pour piano »Gaspard de la nuit de Maurice Ravel,
d’après Aloysius Bertrand
à
Maurice Ravel, compositeur, disparu il y a 70 ans
Aloysius
Bertrand, poète
Mickaël
Défossez, musicien et silence
Aux
oiseaux tristes.
Ce travail se veut une démarche ouverte. Il se propose d’approcher la possibilité d'un lien esthétique tangible entre la composition de Maurice Ravel et le recueil de poèmes d’Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit. Un lien qui ne soit pas appréhendé comme une simple anecdote : Ravel qui trouverait dans un vieux grenier le recueil empoussiéré et déciderait, séduit par la « bizarrerie » du recueil, d’en mettre en musique trois poèmes sous l’égide pianistique de Liszt. En effet, ce n’est pas ainsi que cela s’est passé. A vrai dire, personne ne peut dire exactement comment cela s’est passé.
La littérature musicale à propos des deux Gaspard est suffisamment morcelée pour que tenter d’en réunir la substance, d’en citer des sources (certes pas toutes) s’avère approprié à la fin de cette année qui a célébré les deux artistes, de la manière située au plus près de cette marge d’indécision de l’œuvre : c'est-à-dire entre littérature et musique, soit de l'une, à l'autre. C’est pourquoi les mélomanes pourront facilement, s’ils désirent en prendre le temps, s’approprier autrement les « trois poèmes pour piano » de Maurice Ravel car si la musique requiert des signes, un langage, ces signes peuvent être abordés de manière phénoménologique : les termes de ce langage qui peuvent effrayer le non musicien ne le devraient pas, car ils sont inspirés du domaine de la perception, comme les mots le sont du contexte de l'expression, et peuvent être proposés comme tels. C’est en effet la culture de performance dans laquelle elle s'inscrit, qui souvent prête à penser que la musique est un monde à part du monde et ne peut être abordée que de manière intellectuelle, quand elle appartient au domaine du sensible.
Cette dernière contradiction se veut ici évitée. Le langage musical est certes abordé dans sa spécificité, car, inversement, il s’agissait d’éviter l’approximation interprétative qui est un danger, parce qu’elle véhicule des idées qui ne sont que des idées, et ce faisant fait croire aux personnes que les choses n’ont plus à être pensées, élaborées par eux-mêmes, qu’ils n’en sont pas capables. Mais cette spécificité est très abordable lorsqu’elle est associée à l’appréciation visuelle de ce qui est décrit, avec des extraits de partitions, choisis pour leur intérêt par rapport à ce dernier aspect. Elle est également ici associée à des éléments qui permettent une écoute active, une écoute analytique des phénomènes décrits. La musique y renvoie sans cesse au poème même lorsqu’elle le met à distance. De ce point de vue la musique de Ravel est très particulière, et si la notion de « modernité » est nécessaire pour légitimer l’importance du compositeur dans la musique du 20ème siècle, elle consisterait certainement aussi dans cette perméabilité au littéraire, cet effacement respectueux de la subjectivité au profit de la référence.
Les titres des œuvres plénières sont en italique et en gras, les pièces qui constituent autant de parties de ces « cycles » sont en italique simple.
Ravel exorciste du romantisme : tous « modernes » !
« Toute
sa vie et même encore 50 ans après sa mort,
Maurice Ravel
fut considéré comme un joli bibelot.
En
bonne place, mais rangé sur une
étagère. »
Marcel
Marnat, avril 2007[1]
Maurice Ravel a dit avoir voulu, avec Gaspard de la nuit « exorciser le romantisme ». Cette (partie de) phrase a fait tellement gloser qu’elle semble être devenue un Kitsch du compositeur. Ce petit homme mince au regard aigu et aux traits fins, volontiers ironique et plutôt distant, est souvent refroidi une seconde fois par les critiques, figé dans le cliché d’un obsessionnel de la maîtrise de son art, dont il a effectivement tenu à connaître, étudier, tous les arcanes. Il n’a pas non plus eu peur d’édifier des œuvres « à la manière de » compositeurs de son temps (deux titres de ses œuvres pour piano le disent explicitement), Chabrier, dont il pastiche le goût du pastiche, Borodine, mais aussi Satie qu’il admirait pour écriture expressive dans l’extrême dépouillement de moyens et ses titres distanciés et provocateurs, Satie dont la solitude était une marge de liberté. Comme il l’aime chez Satie, il appréciera la coloration archaïque et la « langue somptueuse »[2] d’Aloysius Bertrand. Ravel sait également tout ce qu’il doit aux œuvres de Couperin dont il édifie un Tombeau, de Debussy dont il déplore l’orchestration et le fouillis dû à la difficulté de son aîné d’accepter de démarquer son écriture des règles de l’harmonie, qu’il contourne. Ravel pour lui choisit de se délester simplement des poids qui le gênent en incluant notamment la dissonance comme élément de langage de ses compositions. Ravel se révèle en effet excessivement libre à l’intérieur du cadre qu’il se donne, et qu’il finit toujours par dépasser : Gaspard de la nuit est une œuvre tonale tout en défiant l’analyse tonale. Jeux d’eau joue deux thèmes de la forme sonate, mais ne respecte ni la forme de développement, ni les limites tonales.
Qu’a-t-il donc pu arriver à Maurice Ravel, en cet été 1908, pour qu’il se fût senti investi du troisième ordre mineur ? A part justifier a posteriori par le verbe « exorciser » une œuvre pianistique de grande envergure, puisqu’elle constitue un triptyque de presque 25 minutes et se réclame d’un poète poursuivi par la poisse sur tous les plans de sa brève existence -et peu connu du grand public, il semble plutôt que la pudeur viscérale du compositeur l'ait amené à justifier d’avoir mis trop de lui-même dans une œuvre tièdement accueillie par la critique, au point que la Revue musicale a « expédié en une ligne ce « Maurice Raval » »[3]. Maurice Ravel était effectivement pudique, et aimait Aloysius Bertrand dont il connut très tôt l’univers poétique. Un témoignage de Valentine Hugo souligne cet aspect du compositeur intime des poètes :
« Cette nuit-là, ce fut Mallarmé, cet Orphée intime disait Fargue, qui fut la cause d’une joute poétique vertigineuse. Ravel qui avait la sensibilité scintillante, rapide, amoureuse de la perfection, citait des vers, des poèmes entiers et, tout à coup, au comble de l’émotion, augmentée de la nôtre, il se repliait dans une plaisanterie sévère, contre lui-même, se perçant d’une piqûre humoreuse pour dissimuler son émoi. Alors Fargue changeait de sujet (…) Et Ravel riait, il était rasséréné, heureux. »[4]
Par « exorciser le romantisme », encore faudrait-il pouvoir s’entendre sur le sens de « romantisme », entre le poème symphonique de Liszt qui se voulait substitutif à un « programme » littéraire et le pianisme virtuose de Liszt auquel ce dernier est bien souvent réduit. Il a pu s’agir également de symboliser aux moyens de l’œuvre d’art telle qu’elle se veut : créée, construite, une littérature personnelle héritée de l’esthétique du dix-neuvième siècle et qui hante : cela est possible, quand l’on sait que Maurice Ravel était l’intime des poètes depuis l’adolescence. Il a peut-être enfin tenté par la création de se distancier des perspectives morbides de cet été 1908, où le père aimé du compositeur déclinait de jour en jour et ne reconnaissait plus même ses proches : tristesse, mort, solitude exprimés par les textes romantiques connus par Ravel… Ou, pourquoi pas encore, créer, construire à partir d’un matériau poétique qui le touchait, sans vouloir cependant céder à la tentation d’une noirceur plus viscérale…
Rusé et n’entendant pas se laisser envahir par une phrase qui ne veut peut-être rien dire, Marcel Marnat a réglé le problème en écrivant que Ravel avait « prétendu exorciser les vieilles peurs du romantismes » avec Gaspard de la Nuit, mais avoué dans une seconde partie de la même phrase jamais citée, « qu’il s’y était laissé piéger ».
Si Gaspard de la Nuit est en effet l’œuvre la plus sombre de Maurice Ravel et un monument, reconnu comme tel, de la littérature pianistique, Marcel Marnat distingue pour lui deux tentations esthétiques et contrastées chez Maurice Ravel : les « œuvres claires (ou tout du moins démonstratives) », et les œuvres « enténébrées », parmi lesquelles il place évidemment les « trois Poèmes pour piano ». Il justifie par ailleurs l’existence des premières par une « nécessité psychique évidente », opposant en cela Maurice Ravel à son aîné Claude Debussy, au tempérament plus unilatéralement saturnien. Pour opposer les deux compositeurs Marcel Marnat oppose encore la stylistique des deux quatuors de Debussy et de Ravel, et souligne à propos du second une « éloquence quasi distanciée ». Il utilise même le terme de « parodie » en réponse à la « subjectivité » du quatuor plus directement post-romantique de Debussy[5]. Il est cela dit amusant de constater que le propos tenu par Marcel Marnat dans sa biographique critique de Maurice Ravel, est exactement le même que celui que tiennent les spécialistes de Claude Debussy! Ainsi, dans un article sur Debussy et le piano :
« Au-delà de l’élégance visuelle, les pianistes découvrent rapidement que la notation de Debussy reste très classique dans son économie aussi bien que dans sa clarté structurelle et polyphonique. Son essence tient à l’équilibre entre la surface d’une musique d’apparence fluide et comme improvisée et la vigueur du classicisme formel qui la sous-tend. »[6] !
Forme, langage… A quelle aune s’agit-il de mesurer le potentiel moderne du créateur, et, du reste, est-ce vraiment la question ? Dans un autre article qui compare la poétique debussyste et celle du compositeur Henri Dutilleux, Maxime Joos rappelle que le Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) est considéré par Pierre Boulez comme « la première œuvre du 20e siècle », que pour Jean Barraqué Debussy est avant tout moderne et précurseur du sérialisme. Marcel Marnat quant à lui relativise ce propos en rappelant que c’est par surcharge harmonique à force de « faire avec » les règles de l’harmonie, dans un souci de résolution toujours latent, que la modernité du langage de Debussy quitte le rivages tonal, comme dans la Mer. En effet pour Marnat c’est Ravel, qui usera de la dissonance en tant que telle et pour commencer, en partant de la perception, pour un langage libéré qui peut par ailleurs être rapproché de l’écriture « hallucinée » du dernier Liszt de Nuages : un Liszt qui frise également avec l’atonalité, mais dont on ne parle quasiment jamais.
Tous résolument « modernes », tous révolutionnaires, magiciens dont les structures formelles les plus classiques deviennent garantes d’une liberté, après que le genre du poème symphonique et de la musique programmatique pour piano aient été poussés, depuis Liszt, jusqu’à leurs derniers retranchements : ce qui amènera un Mahler à revenir à la symphonie dont Debussy a estimé que « depuis Beethoven, la preuve de l’inutilité était faite »: et c’est le « programme » de Malher poussé aux confins du Terrestre. Sa 2e Symphonie, qui intègre des textes autrement plus métaphysiques que l’Hymne à la joie, s’appelle en effet « Résurrection », sa 3e Symphonie se conclut sur un mouvement final merveilleux qu’il a nommé « ce que me conte l’amour ». La porte des anges ne s’ouvre que dans sa 4e Symphonie. Nul doute que le rapport entre la musique et l’idée ne s’est pas amoindri depuis que Liszt a opposé dans deux thèmes contrastés les méchants et les gentils (ce qui était déjà un bon début) dans des poèmes symphoniques dont les prétextes littéraires n’étaient alors, au-delà de la transcription pour piano, que des prétextes en effet, soumis à l’expression d’une lutte allégorique entre deux thèmes antagonistes : lutte propice à explorer toutes les ressources du « piano orchestral ».
De la même manière, par rapport au langage il semble réducteur d’opposer dans le cheminement d’un artiste et comme il en est question de manière très particulière au début de 20e siècle, la tendance à la « modernité » d’une part, et la tentation, toujours reprochée a posteriori, du post- romantisme ou encore d’un néo-classicisme jugé ringard… L’exemple d’Alban Berg peut aisément abolir la pertinence d'une telle dualité. Alban Berg fut un disciple de l’Ecole de Vienne initiée par Arnold Schoenberg : Schoenberg qui propose d’éradiquer les pôles de l’échelle tonale, et invente l’échelle des 12 sons (dodécaphonisme), puis un principe de composition sériel, avec des paramètres sonores inédits. D’où une musique expressionniste en diable pour les initiés, cacophonique pour le commun, et froidement intellectuelle pour les grands sentimentaux adeptes de la musique tonale poussée dans ses derniers retranchements, au nom de l’expressivité, par Wagner, puis Strauss, Brahms, Mahler, que tout le monde fait semblant de détester par ce qu’ils sont Allemands et qu’en ce début de siècle la musique allemande est très mal perçue[7] comme le montre d’ailleurs Proust à la même époque dans le Temps retrouvé.
Alban Berg a écrit en 1904 Sept Lieder de jeunesse d’inspiration clairement post-romantique. Schoenberg raconte sa première rencontre avec son futur élève
« Quand Alban Berg vint à moi, en 1904, c’était un grand garçon extrêmement timide. J’examinai les compositions qu’il me soumit, des lieder écrits dans un style qui se situait entre Hugo Wolf et Brahms, et je reconnus aussitôt en lui un véritable talent. ».
Or Alban Berg deviendra le compositeur de Lulu et de la Lulu-suite, sorte de « bande-annonce » de l’opéra, avant la sortie l’opéra (du jamais vu), de Wozzeck, du sublime Concerto à la mémoire d’un ange dont le thème consiste en l’énonciation des cordes à vide du violon montant et descendant en quintes brutes successives : or les quintes sont les Ennemies des règles d’harmonie (on se souvient du maître de chapelle Kreisler de Hoffmann, qui tente de se donner la mort en se poignardant avec une quinte). Pourtant l’œuvre de Berg, malgré le langage sériel dans lequel elle s’inscrit jamais ne perd cette expressivité presque doloriste aux grands intervalles mélodiques dont la sensibilité palpable est véhiculée par les contraintes les plus astreignantes et les formes les plus anciennes, qui la structurent (un long passage de Lulu consiste en une passacaille[8]). Alban Berg ne renia d’ailleurs jamais l’expressivité dans sa musique, ni sa musique de jeunesse elle-même, puisqu’en 1928 il reprend et orchestre ses Sept Lieder de jeunesse[9], aux forêts orchestrales de Strauss, aux intervalles tendus d’une expressivité doloriste qui évoque absolument Mahler dans une musique toutefois plus immédiate, plus rapide dans son accession à la jouissance expressive, que Mahler concentre souvent dans ses mouvements lents et qu’il faut savoir attendre ... Le troisième lied du cycle de Berg, die Nachtingall (le Rossignol), d’après le poème de Théodor Storm, semble de ce point de vue avoir choisi de faire programme avec la création elle-même à travers le choix du texte choisi :
« C’est
l’œuvre du rossignol,
qui a chanté toute la
nuit
et qui, de son doux chant
renvoyé par
l’écho,
a fait éclore les roses.
Elle
n’était
pourtant que fougue
et la voilà
profondément recueillie,
tenant à la main son
chapeau d’été,
endurant en silence
l’ardeur du soleil
et ne sachant
qu’entreprendre.
C’est
l’œuvre du rossignol,
qui a chanté toute la
nuit,
et qui, de son doux chant
renvoyé par
l’écho,
a fait éclore les roses.
Le rossignol, la rose, la voix, le poète et le compositeur tout ensemble semblent étreindre la création dans l’ampleur de sa réalisation sonore. Cette œuvre, sublime, brève (2 minutes) peut laisser songeur lorsque l’on sait qu’Alban Berg s’est endormi pour toujours à l’âge de cinquante ans des suites d’une piqûre de rose…
Pierre Boulez, héritier l’ Ecole de Vienne et qui vient en tant que chef d’orchestre d’enregistrer la 8ème Symphonie de Gustave Mahler, trouve à l’inverse que c’est Mahler, qui fait penser à Berg,
« qui a lui-même réussi à mettre en œuvre deux principes en apparence contradictoires : un formalisme structurel assumé en même temps qu’une extraordinaires fluidité narrative »[10].
Comme Debussy! Et comme Ravel! A croire que cette phrase, que chaque spécialiste applique à l’œuvre de son compositeur favori, est une phrase passe-partout… ou bien, que la forme n’est peut-être importante que dans la mesure où elle garantit à l’œuvre un équilibre. Cette dernière idée -plutôt culottée -qui sous-entend une conception de la musique pure, est exprimée par Glenn Gould à propos du genre du poème symphonique (genre qui nous intéresse, justement, par rapport aux « poèmes pour piano ») et de la conception de Strauss, qui en a composé beaucoup et avec lequel, notamment, de genre foisonnant il est devenu une sorte de monstre hybride, une énorme anomalie où la musique l’emporte sur toute velléité de « programme ». Mais, comme le remarque Gould,
« l’auditeur se moque des déboires conjugaux de Till Euslespieler et des convictions philosophiques de Zarathoustra.[…] Dans son esprit, le grand avantage de la logique du poème symphonique était de fournir une cohérence architecturale qu’il n’était pas nécessaire d’observer de l’extérieur. »[11]
Chacun ses références, chacun ses référents que la relation entre comparant et comparé peut mettre comme ici en évidence, à moins que de l’abolir, et qui tend à prouver que la relation chronologique et la notion d’ « héritage » et par là même celle de « modernité » sont, comme toute, relatives lorsque les créateurs ne se réclament pas intellectuellement d’un courant, ne cherchent pas forcément à s’inscrire dans une filiation. Mais alors, attention s’ils veulent figurer au panthéon des historiens de la musique, dont on trouve un savoureux échantillon des possibilités de jugement et de catégorisation dans l’introduction de l’ouvrage de Von der Weid intitulé ni plus ni moins que « la Musique du XXe siècle » où l’auteur ose ceci, entre crochets:
« [il aurait été superflu tant la littérature abonde de traiter des musiciens de transition tels Gustav Mahler (1860-1911), Richard Strauss (1864-1949), Max Reger (…), Satie (…) voire des compositeurs comme Maurice Ravel (1875-1937), Serge Prokofiev (1891-1953), au parcours aussi génial que particulier et original, mais dont l’inexistence n’aurait pas infléchi le cours de l’histoire musicale.] » [12]
Devant de tels jugements à l’emporte-pièce où le terme d’ « inexistence » plus que tout autre peut heurter, et dont la liste de compositeurs n’est pas anodine puisqu’elle concerne des musiciens ayant poussé à l’extrême leur créativité dans des domaines qui n’ont pas été spécifiquement et obsessionnellement liés à la volonté de nier une écriture musicale antérieure, on peut se demander dans un perspective telle, ce qu’est, ce que représente, ce que prône, une « histoire de la musique » sinon des considérations suspectes et réductrices.
Henri Dutilleux, compositeur et penseur de sa propre musique en regard des prédécesseurs dont la poétique (et non la modernité de facture ou de langage) qui ont pu l’inspirer- dont Debussy- rejoint en cela la pensée de Jankélévitch en privilégiant l’esthétique à l’analyse[13]. Cette attitude est intéressante pour notre propos, car si elle ne s’impose pas à l’historien de la musique pour qui il s’agit d’ « évolution », de « ruptures » pour obtenir une place au palmarès des compositeurs qui comptent (« tous modernes ! »), elle est inévitable pour qui s’intéresse aux possibles de la création musicale, et a fortiori au phénomène particulier qui consiste en la mise en musique de textes poétiques : avec, ou sans leurs mots.
Deux Ondines, deux démarches créatrices: Claude Debussy et Maurice Ravel
L’Ondine de Debussy appartient au second volume des Préludes composés entre 1910 et 1912, soient quelques années après le Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel (1908). Une petite étude comparée des deux œuvres peut s’avérer intéressante en ce que la pièce de Debussy met en valeur à la fois des éléments de l’écriture ravélienne originaux dont elle s’inspire, et adhère cependant à une forme « classique » dont l’ Ondine de Ravel se démarque. Elle ne se réclame pas du poème d’Aloysius Bertrand dont Debussy a, cependant, forcément pris connaissance.
Le pianiste Alfred Cortot décrit ce prélude de manière linéaire. Pour lui le scherzando qui en indique le tempérament, la mesure qui lui correspond (ternaire, il s’agit d’un 6/8), enfin la tonalité claire (ré Majeur) évoque la sirène des eaux douces « parmi les frétillements de vrais poissons ». Rien du nocturne, que constitue a priori, l’ondine de « la Nuit et ses prestiges ». Il existe bien quelques tensions, dont une pédale[14] de mib Majeur où la créature « essaie de séduire quelque humain », puisque c’est là l’essence du mythe. Une autre pédale, de dominante, correspond pour Cortot à une « âpreté méchante » : l’ondine séduit le fiancé élu pour mieux le perdre… ou s’en venger, selon les sources littéraires. Enfin, un même procédé d’écriture de la disparition (des arpèges dont la nuance diminue jusqu’à la complète dissolution) clôt une histoire qui semble même dans les trois œuvres de Debussy, Ravel et Bertrand.
Cependant, ajoute Cortot, « la pièce diffère considérablement de l’Ondine de Ravel en ce qu’elle ne contient aucune virtuosité pour elle-même, tous les traits faisant partie de la substance musicale. » Outre le fait que l’expression de « virtuosité pour elle-même » me paraît inadéquate également pour l’œuvre de Ravel (sans doute s’agit-il encore d’un reliquat de la croyance héritée du Kitsch « Ravel-héritier-liztien » dont on nous rebat les oreilles parce que Ravel eut le malheur de dire qu’il rêvait de composer pour Gaspard des pièces de « virtuosité transcendentale ([à la manière de l’Islamey de Balakirev !] » Il semble que la comparaison entre les deux pièces se pose sur un plan plus intéressant que la dialectique virtuosité/langage essentiel : il paraît plus pertinent en effet de poser l’œuvre de Debussy comme étant de structure très définie (un scherzo qui joue de trois thèmes avec un développement cyclique) dont la partition de Maurice Ravel, pour elle, s’éloigne, à travers la notion de « Poèmes pour piano » de son sous-titre.
En effet, une structure très repérable dans l’œuvre de Debussy (développée ci-dessous) d’inscrit dans l’héritage du scherzo romantique jusque dans un simili refrain, et en même temps l’héritage cyclique post-romantique, qui permet un retour de thèmes clairement repérables et différents les uns des autres :
|
Introduction |
Ecriture en croches staccato et triolets de doubles croches : écriture d’une danse rythmée et néanmoins aérée |
… « // » (respiration) |
|
1ère partie Thème 1 |
|
… « Rubato » |
|
Thème 2 « Au mouvement » |
notes répétées ascendantes phrasées par 2 : « à l’aise » |
… « Retenu » |
|
Thème 3 (véritable thème : équilibre mélodique et rythmique) |
« en dehors » et a capella[15] |
|
|
Thème 1 |
« très doux » précédé d’appoggiatures « scintillant » |
… « Retenu » |
|
2e partie Thème 3 |
varié dans les aiguës |
|
|
Thème 2 |
|
|
|
Thème 3 |
« aussi léger que possible » « a capella » « le double plus lent » |
|
|
Thème 3 |
« doucement marqué » puis variation d’une page entière |
… « Mouvement », changement d’armure[16] |
|
Thème 3 |
dans les graves |
|
|
Thème 1 |
PP subito |
|
|
Coda |
Arpèges en cascades PP |
|
La pièce de Claude Debussy s’inscrit donc dans une structure claire de scherzo plutôt libre, mais balisée par les indications de tempo et la présence de trois thèmes identifiables, notamment le thème 1. En cela elle montre, nonobstant une modernité d’écriture dont le « pianisme[17] » est évidemment hérité pour beaucoup du Jeux d’eau de Ravel (et des fluidités de son Ondine dont elle est la « sœur injustement méconnue » d’après René Tranchefort[18], l’attachement au classicisme de la forme et au thème cyclique propre aux post-romantiques (Chausson, Franck…). Il s’agit d’une esthétique de la discontinuité, avec une grande variété de tempi, des interruptions de discours, de multiples indications qui indiquent différentes intentions dont l’interprète doit tenir compte. Cette esthétique d’un tout tissé d’éléments distincts et contrastés, cette sorte de patchwork sonore, est ce dont se démarque totalement l’Ondine de Maurice Ravel qui, il est vrai, a un poème entier comme argument, ce qui distingue absolument les deux démarches esthétiques malgré des ressemblances dans l’écriture musicale.
Il semblerait qu’ici le dépouillement de l’écriture debussyste, comparativement à la matière certes fluide mais très dense de Ravel, révèle surtout une distance à son objet (confirmée par le parti- pris formel) dont la présentation des pages de musique, déjà, d’un point de vue intertextuel, suffirait à expliciter la démarche. D’un côté en effet, un « programme » au sens lisztien du terme : le texte d’Aloysius Bertrand imprimé en face de la première page de musique chez Durand dans l’édition complète. Dans tous les cas, un poème avec son titre et accompagné de son sous-titre « extrait de Gaspard de la Nuit, 3 poèmes pour piano d’après Aloysius Bertrand ». Il y a donc au sens propre comme au figuré une inscription de la page musicale en regard du poème littéraire romantique, ce qui n’est évidemment pas le cas des Préludes de Debussy, dont le titre « …Ondine » clôt la pièce d’une pièce elle-même placée au cœur d’un recueil de Douze Préludes, comme pour proposer à son interprète des images héritées de la référence collective a posteriori : des images d’anthologie. Je dirai que cette démarche rend peu pertinente l’analyse, très descriptive, de R. Tranchefort appuyée sur les remarques d’Alfred Cortot. Le troisième thème d’Ondine semblerait en effet seul pertinent, en tant que l’incarnation de la créature : seul « vrai thème » développé et effectivement varié, que représenterait à la manière du leitmotiv wagnérien et dans sa rythmique insolente le personnage lui-même. Du reste, sa première présentation a capella force le parallélisme (et le contraste malgré une similitude flagrante du procédé) d’avec l’ultime du chant de l’Ondine de Ravel (car il s’agit bien d’un chant et non de la créature elle-même dans l’œuvre de Maurice Ravel).
Poétique musicale de Ondine
Chez Ravel en effet la matière musicale consiste dans une « fluidité » réaliste et néanmoins stylisée, une densité onirique de l’écriture qui transporte les sens et évoque un univers sans que l’analyse soit forcément nécessaire. Elle met en scène non tant un thème qu’un discours, une mélodie au sens large du terme –et poétique : il s’agit bien de la « chanson murmurée » d’Ondine. Cette mélodie est une incarnation auditive de la prière de l’amoureuse dans le poème d’Aloysius Bertrand. C’est ce qui fait que le scherzando de Debussy en tant qu’indication musicale pour une interprétation de caractère dansant, s’oppose au « lent » demandé par Ravel. Car, comme le souligne Pierre Brunel
« Ondine est un nocturne. C’est ce qui justifie (…) le mouvement lent adopté par Ravel (…) Ondine est un nocturne. C’est une berceuse, la berceuse d’un dormeur. » [19].
Précisons encore que ce tempo est de toutes manières nécessaire à l’inscription audible de la mélodie dans la matière sonore dont elle est poétiquement issue et indissociable. Guy Sacre parle du « thème d’Ondine : la fée aquatique, frissonnante de trémolos, de glissandos et d’arpèges, avec son beau thème tendrement blotti (lent) au milieu des éclaboussures de triples croches ».[20]Et si, à la fin, élément liquide et discours se distinguent, c’est pour mieux disparaître l’un dans l’autre, l’un, puis l’autre…
C’est donc le chant lui-même de l’ondine, qui surgit de sa matière versicolore, et si l’héritage de Liszt existe il ne consiste certes pas dans une démarche virtuosiste à outrance, mais plutôt au sein de la démarche d’une texture aquatique servie par la densité de l’écriture, telle dans les Jeux d’eau de la villa d’Este des Années de pélerinage (1877). Le mot « texture » prend d'ailleurs tout son sens si l’on observe attentivement les premières mesures de chacune des deux œuvres.[21] La rencontre de Ravel avec le dernier piano Liszt, celui de Saint-François d’Assises, le Sermon aux oiseaux et de Saint-François d’Assises marchant sur les eaux (deux Légendes) est déterminante dans la mesure où Liszt a voulu asservir à son œuvre toutes les possibilités expressives du piano dans la stylisation de l’élément liquide, nonobstant un certain classicisme de la structure : comme celle des Jeux d’eau de Ravel ainsi que l’indique le compositeur lui-même en ce qu'elle consiste dans une dualité thématique, traditionnelle:
« Cette pièce inspirée du bruit de l’eau et des sons musicaux que font entendre les jets d’eau, les cascades et les ruisseaux, est fondée sur deux motifs, à la façon d’un premier temps de sonate, sans toutefois s’assujettir au plan tonal classique »[22] .
Irréductible poésie de la composition de Maurice Ravel inscrite dans un cadre et cependant libre à la manière du rapport entre ses titres, ses épigraphes et ses pages de musique. Poésie dans le rapport de la musique à son sujet, voire au-delà de son sujet : Jeux d’eau comme musique inspirée de la musique elle-même entendue dans les sons que compose la nature… La fin des Jeux d’eau de Maurice Ravel procède d’ailleurs exactement de la même manière que la fin de Ondine : toute en vagues sonores ascendantes et descendantes d’arpèges brisés, avec la même demande exactement :« sans ralentir » qui tient davantage de la didascalie que de l’indication de tempo. Un témoignage précieux de la pianiste, élève puis, à la fin de sa vie, amie du compositeur Henriette Faure, répertorié parmi tant d’autres dans l’excellent ouvrage de Maurice Marnat[23], nous renseigne sur la valeur poétique de l’interprétation ainsi demandée. La jeune femme ayant joué la fin des Jeux d’eau sans intention particulière, dans le souci de ne surtout pas ralentir elle s’entend dire par le maître
« vous
pouvez rêver
un peu à la fin[24]
à condition…
-… de
ne pas
m’amollir ».
Ondine, certes, dépasse la linéarité de son discours mélodique dans sa poétique musicale pour le rêve éveillé dans la matière sonore qui permet le songe, qui constitue-ou que constitue- le texte de Bertrand. Marcel Marnat souligne ce rêve de poème et de musique rendus possibles à l’écoute de Ravel. D’une manière exactement inverse de celle de Debussy, Ravel
« pose l’image au début mais la déborde et entraîne ainsi l’auditeur à aller vers des régions insoupçonnées : Guillaume Apollinaire parlera de « l’ordre et de l’aventure » et même de sur-réalisme. Cet intime recentrage esthétique ne sera pas systématiquement appliqué mais il inspirera la série des œuvres graves de Ravel(…) Avec cette conscience nouvelle du parti à tirer des résistances du réel, Ravel s’éloigne donc définitivement de l’art debussyste dont le désespoir latent relève (…) si peu du spectacle du monde.»[25]
Bien sûr, le « chant inopérant » d’Ondine, tel que le décrit Marnat, ne pourrait sans contresens poétique s’arranger d’un second thème pour la raison même qu’il est le chant, la manifestation poétique d’Ondine en tant que voix, comme dans le poème. Pierre Brunel insiste clairement sur ce point à propos du poème romantique : « Le poème en prose d’Aloysius Bertrand, avant de devenir prétexte à une évocation musicale, est un chant » [26]. Et c’est en tant que tel que Ravel met ce chant en musique. Du reste René Tranchefort[27] et Guy Sacre[28]voient un seul thème dans Ondine de Maurice Ravel : « on peut voir dans la pièce l’expansion recommencée d’un thème unique ».[29]
D’aucunes analyses comme celle de Cécile Reynaud[30] proposent un second thème dans aa reprise, après quelques fluidités dudit discours mélodique (mes. 33). Or ce « second thème » ne serait d’une part nullement différent, esthétiquement, du premier tel que nous l’avons décrit. Serti de ces mêmes triples croches répétées sur un accord de quinte augmentée, énoncé en douces croches et noires liées, il s’agit plutôt d’une reprise de ce même chant distraitement laissé suspendu quelques mesures un peu plus tôt dans les aiguës, comme si d’ailleurs cette reprise du discours correspondait à se reprendre, soi, Ondine au tempérament hystérique perpétuellement ballottée entre haine et séduction, douceur voulue et exaltation douloureuse impossible à réprimer. Pour Pierre Brunel Ondine est également la « dame châtelaine », une Mélusine aux maléfices de féé-serpent. De ce point de vue Ondine-Mélusine, féé-serpent et châtelaine de Lusignan, peut évoquer sans difficulté dans sa duplicité reptilienne même le serpent de l’Ancien Testament dont Eve, son incarnation tentatrice, propose à l’homme de croquer dans le fruit interdit. Celle que Chopin aurait prise selon Cortot comme programme de sa 3e Ballade, issue de Mickiewicz, est plus ambiguë car il s’agit d’une mortelle trahie qui se venge dans son malheur. L’ambiguïté, la duplicité peuvent être d’ailleurs chez Ravel reconnues dans les quatre triples croches, juste avant la seconde émission du chant, où se frottent doucement un sib et un si bécarre si bien qu’on ne sait plus si l’on est en majeur, ou en mineur, voire les deux simultanément (peut-être d’ailleurs le si bécarre est-il sensé constituer une tierce picarde[31] ?) :

On peut en effet tout imaginer d'après les trois Ondine des poètes antérieurs au texte de Bertrand : Heine, dont est surtout développée la « séduction perfide » de la voix du personnage ( et dont le texte a inspiré les lieder de Silcher, Schumann, et Liszt), Brentano, qui insiste comme Mickiewicz sur l’infidélité du fiancé. Pour Helen Hart Poggenburg la châtelaine « pourrait tout aussi bien être, nous semble-t-il, une troisième personne, instrument d’un voyeurisme équivoque » [32]. Il existe en effet d’autres poèmes où une tierce présence observe qui n’avait pas été vue: la Tour de Nesle, Messire Jean, mais encore le dessin par Aloysius Bertrand lui-même d’un couple à sa fenêtre qui évoque celui de la fin de la Tour de Nesle. On peut aussi imaginer qu’elle est cette « mortelle » elle-même dont parle le narrateur, et que le poète prendrait ainsi le mythe à contre-pied : la bien-aimée ne sera pas trahie, d’où les rires et pleurs mêlés d’une vengeance devenue toute inutile puisque le fiancé ne sera jamais entraîné dans le triangle universel alchimique, et symbole d’une féminité fascinante et secrète qui fait de l’Ondine un personnage des profondeurs, un archétype féminin… ce qui permet très vraisemblablement à Alfred Cortot, dans le très formel prélude de Debussy où elle n’est pas approchée comme un mystère et d’où la dimension psychologique est exclue, de l’imaginer malgré tout « tentatrice », « et nue » par-dessus le marché!
La seconde proposition d’un décidément « second thème »très désiré[33] consisterait dans la mise en place de l’implacable cataclysme qui constitue à la fois l’aboutissement de la démarche séductrice, et le point culminant de l’œuvre dans le 3e système de la p. 7 de la partition[34]. Cela paraît encore une fois improbable en regard de la dynamique structurelle de l’œuvre. Hélène Jourdan Morhange, citée par Marcel Marnat, avait remarqué combien les œuvres de Ravel consistaient presque toujours en un crescendo-decrescendo avec en son centre un point culminant[35]. Quant à Pierre Brunel, il interprète poétiquement une telle structure crescendo-décrescendo: avec son point culminant comme point central de l’œuvre :
« L’apparence humaine d’Ondine, sa fausse humanité, cèdent le pas à une puissance surnaturelle qui elle-même a échoué devant la force du simple amour d’un mortel pour une mortelle. »[36] Point central de l’œuvre, mais encore épicentre symbolique : « le triangle des élements primordiaux constitue l’harmonie universelle, la connaissance suprême selon les alchimistes. »[37]
Cette analyse se rapproche du « chant léger et inopérant » ainsi caractérisé par Marcel Marnat, et de l' hypothèse d’une créature tentatrice avant toute chose, susceptible de perdre l’être humain auquel elle s’adresse en lui faisant goûter du fruit de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal» [38]…
D’autre part, on sait que Maurice Ravel fut, lors d’une seconde session au Conservatoire de musique, l’élève de Gédalge : session volontaire, session volontariste même, car il avait compris la nécessité de maîtriser tous les arcanes de l’écriture musicale avant que d’ approfondir ses propres recherches de création. Gédalge lui avait transmis un sens mélodique exacerbé, qui mettait au défi ses élèves de composer « huit mesures » d’une mélodie susceptible de se suffire à elle-même sans qu’il lui fût besoin d’un accompagnement. En l’occurrence, ce sont ici quatre mesures a capella qui constituent l’ultime rappel de la mélodie d’Ondine, et son ultime invite également après la déferlante en modulations successives qui semblent atteindre l’épicentre universel promis par la créature fantastique (« très lent », dernière mesure de la p.11 de la partition) avant l’éclatante dissolution en rires et sanglots jusqu’à l’ultime rappel sur quatre notes de son thème, répétées elles-mêmes quatre fois (« retenez peu à peu » p.12). Puis l’évanouissement se confond avec les gouttes de pluie qui frappent les losanges bleus de la fenêtre, dans la lumineuse tonalité d’ut# Majeur initiale. L’enchantement est rompu et les lumineux accords de tonique augmentés ne sont plus. Ne reste que l’élément liquide, identique, comme nous l’avons vu, à la fin de Jeux d’eau.
Pour Pierre Brunel et dans une telle perspective monothématique, il s’agit d’une « rhétorique de la répétition et de la reprise[39] ». Il ajoute que « Bertrand joue donc avec l’art proprement musical de la variation, que Ravel a su retrouver ». La « continuité réelle » chez Ravel s’oppose ainsi à la « discontinuité apparente » de Debussy. Or pour Pierre Brunel la discontinuité est justement ce qui distingue le poème en prose du simple récit. Ces deux aspects sont déjà présents dans le poème d’Aloysius Bertrand, de par le jeu inverse d’une chanson et d’un récit qui s’imbriquent l’un dans l’autre, et font œuvre :
« Bertrand s’est contenté de juxtaposer une chanson (expression directe) à un fragment narratif (expression indirecte) ».
Il existe une continuité de la « prose musicale qui le temps d’un poème en prose imprimé sur la partition et doit être lu en concert semble bien avoir pris la chanson d’Ondine pour modèle et l’avoir épousée. » La continuité du discours est renouvelée par la variation et l’évocation épouse, grâce à la stylisation poétique au sens le plus spécifiquement littéraire du terme, une structure double de chanson en versets, et de progression dramatique à travers la notion l’intensité au sens musical (les nuances) et littéraire du terme: une apparition, un paroxysme amené, puis la disparition qui ne laisse rien que le frisson de l'oeuvre tangible. La musique dit le poème, et se dit poème ainsi que l’exprime le sous titre du Gaspard de la nuit de Ravel: « Poèmes pour piano ».
Repères pour une écoute active
Une interprétation très sobre et conforme en cela aux souhaits de Ravel par rapport à la fidélité du texte et des indications intertextuelles qui figurent sur la partition musicale, est choisie pour la proposition d’écoute commentée dont les repères sont indiqués ci-dessous. Elle devrait être facilement disponible dans le commerce : il s’agit de Maurice Ravel, Complete piano works par Jean-Efflam Bavouzet chez Mdg, 604 1190-2, 2003. Evidemment, de nombreuses versions font référence : Vlado Permuter, Samson François… Pogorelitch notamment pour Scarbo ( Le Gibet est par contre interprété par Pogorelitch de manière critiquable par rapport à l’interprétation prescrite par le compositeur. Sans doute faut-il lui préférer selon le conseil de Pierre Brunel la version de Claudio Arrau, voire écouter l’enregistrement du rouleau mécanique interprété par Ravel lui-même en 1920).[40]
Pour la partition: Maurice Ravel, Ondine, édition séparée chez Durand S.A Editions musicales, réimpression toujours fidèle à l’édition de 1908 : toutefois, cette édition séparée ne comporte pas le texte d’Aloysius Bertrand même si le poète figure dans le sous-titre de la page de titre.[41]
|
Analyse |
Commentaire |
Repères CD |
Repères partition |
|
Introduction : « éclaboussures de triples croches » (Guy Sacre) en ostinato |
Stylisation de l’environnement aquatique |
|
|
|
Thème d’Ondine tendrement blotti (lent) »en do# /Déclinaison transposée sur ré#/retour en do#M avec le thème et sa doublure à l’octave, arpégée |
« chant inopérant » selon M. Marnat ensuite réitéré plus aigu et doublé à l’intérieur des trémolos dans sa tessiture d’origine |
0’06/0’50 |
mes.3 & 4/4 mes.9 |
|
Suite du discours crescendo accompagnement en arpèges brisés qui remplacent les trémolos, en triples puis triolets de triples croches (densité de l’écriture en horizontalité et impression de mobilité) |
La stylisation de l’eau participe du sortilège |
1’00 |
mes.15 |
|
1er glissando et reprise de l’accompagnement de trémolos mêlés aux arpèges brisés, crescendo qui préfigure la volonté de convaincre/séduire |
Discours réitéré dont l’accompagnement souligne la séduction croissante sans doute, et toujours plus sophistiquée |
1’21-1’35 |
4/4, mes.23 |
|
Trémolos de l’introduction |
Pause du discours, articule le poème : « blanc » entre les strophes ? |
1’51 |
mes. 31 « au mouvement » |
|
Suite de la mélodie d’Ondine En sol# (un peu plus grave mais à la même tessiture : chant encore plus doux. |
C .Reynaud voit un 2e thème, cela paraît improbable car il s’agit du même accompagnement et le schéma mélodique est similaire : glose du premier discours/tentative de séduction par la variation (minime) |
1’51 |
mes. 33 |
|
Arpèges, densification de l’accompagnement sur des réitérations successives de cette deuxième partie de discours |
« on peut voir dans la pièce l’expansion recommencée d’un thème unique » |
2’16 |
4/4,mes. 38 |
|
Thème 1 avec des resserrements d’arpèges dans les aiguës qui « excitent » le discours en arabesques |
Quintolets, sextolets de triples croches qui donnent à l’écoute l’impression d’une densification un peu hystérique (dans les aiguës) et non mesurée (impossibilité de l’exactitude mathématique de ces figures rythmiques) |
2’35/2’42/2’44/2’45/2’49 |
mes. 43 |
|
Première apparition du mouvement ascendant sur 4 notes suivi du thème initial |
Préfigure l’ascension dans les graves en tant que discours symbolique des origines et d’un centre universel ? |
3’11 |
mes.46 après le changement d’armure |
|
2ème partie de la mélodie d’Ondine |
Versions « hispanique », arpèges comprenant une 2de augmentée (effet de sensualité, de tension), « jetés » par la main droite, les deux mains se partagent le thème- une note sur deux. Dernière version densifiée, en accords de 4 sons. |
3’21 3’40/3’34 |
4/4, mes.53 |
|
Déferlante en secondes et tierces qui évoque davantage un déchaînement amorcé de l’élément liquide (les « gouttes d’eau » ne sont plus qu’un souvenir) que le « discours symboliste » (promesse d’Ondine qui masque la dangerosité, peut-être la disparition de celui qui la suivra). Il s’agit de ici de masses aquatiques, une densification de la matière. |
chromatisme masqué qui évoque l’entrée du piano dans le 2e mouvement du 3e concerto pour piano de Rachmaninov : influence de la musique russe, « orientalisme » d’une écriture qui ose la dissonance, à laquelle on sait que Ravel était sensible |
3’40 |
4/4,mes. 58 |
|
Grande montée par groupes de 6 notes rythmiquement égales en succession de modes sucessivement : -« éolien » (de la) -« mixolydien » (de sol) -inédit :mélange des deux -« mixolydien »[42] |
« triangle » des éléments ? grand crescendo qui peut tout aussi bien traduire la démesure de la promesse que celle de l’élément aquatique : amplitude maximum dans l’utilisation du clavier |
4’01 |
mes. 63 |
|
Grande descente : mélange de gamme par ton et de résolution ½ cadence tonale sur les deux dernières notes si mineur avec arrêt sur la sensible ré# |
Remarque : cette descente pourrait être une variante de la tête (début) de la seconde partie du thème d’Ondine. |
4’26 |
mes.67 : un peu plus lent |
|
Grande conclusion : dissolution du grand lyrisme qui précèdait, « effets » aquatiques |
Glissando ascendant successivement sur les touches blanches du piano puis touches noires Décomposition du trémolos en arpèges brisés sur fa#M avec ré# répété par l’auriculaire de la main droite |
4’50 |
mes. 73-76
mes.76 |
|
Réminiscence du thème d’Ondine à son début |
Mélange de trémolos et arpégés: leur mouvance sur le clavier du médium à l’aiguë… |
5’31 |
mes.80, 4/4 |
|
Thème a capella sur 4 mesures (on se souvient de Degalge maître mélodiste de Ravel : écrire une mélodie de 8 mes. qui pût être jouée sans accompagnement. |
Semble épouser dans la figuration et la stylisation la fin du texte « mais comme je lui dis que j’aimais une mortelle (…) » Tonalité de ré mineur : plus de # à foison, comme si le thème avait perdu de sa lumière séductrice, que le charme était rompu.
|
5’55 |
Mes. 85, 3/4 très lent |
|
Soudains arpèges fortissimo décalés aux deux mains : dissonances |
Rires et larmes mêlés ? |
|
mes. 89 : rapide et brillant |
|
Résolution et diminuendo sur la tête du thème muté (modifié dans ses intervalles mais reconnaissable) |
|
6’26 |
mes.90-91 Retenez peu à peu |
|
Disparition sur l’arpège de do#M, tonalité principale du morceau décalés aux deux mains |
« sans ralentir », même procédé que la fin de Jeux d’eau : Ondine a disparu : ne reste que l’élément liquide, et sa constance sur les fenêtres aux losanges bleux. |
6’42 |
mes.92 au mouvement du début |
Evidemment, 94 mesures seulement pour autant d’évènements musicaux, cela évoque la concentration et la brièveté du poème en prose : à la fois embrassé à travers la pièce de Maurice Ravel et transfiguré dans la matière sonore qui est une véritable texture, un tissu expressif à proprement parler « absorbant ». Aucun figuralisme, si ce n’est la stylisation de l’élément liquide. Cependant, la progression dramatique est repérable à travers les notions de tempo, les changements d’armure qui modifient la couleur de la matière sonore. Ces modifications s’assimilent à la progression dramatique du discours de la créature en un grand crescendo central, comme dans beaucoup de pièces de Ravel et notamment Jeux d’eau auquel on l’a beaucoup comparée (sans doute dans ce sens). Suivre la partition pour le mélomane qui ne joue pas Ondine peut être intéressante dans la mesure où les repères audio précis permettent d’identifier certains procédés d’écriture et certains éléments de langage musical. D’un point de vue strictement esthétique, la place prise par les mesures à cause de la densité sonore (toute texture) est impressionnante : parfois il faut une ligne de partition pour une mesure de musique (la plupart du temps pour deux mesures). Des indications intéressantes peuvent permettre des hypothèses de jeu, comme celle de jouer les trémolos à la main droite et le thème à la main gauche, ou encore le grand glissando après l’explosion centrale qui se partage aux deux mains : ces hypothèses seront facilement confirmées, ou infirmées, par la visualisation de vidéos disponible sur le site « Youtube »[43] dont celle de Vlado Perlemuter. Enfin, le choix par Ravel de trois portées permet une lisibilité des divers plans sonores qui peut être, conjuguée à l’écoute, également très éclairante.
Dans le triptyque de Gaspard de la Nuit le Gibet prend une place qui peut être considérée comme symbolique par le lecteur rêveur du recueil, à l’écoute de cet avatar de « second mouvement » de l’œuvre de Maurice Ravel. En effet, la place centrale comme le remarque Pierre Brunel, est celle du « mouvement lent» de la sonate en trois mouvements, ou encore celle de la seconde partie avant le retour de la première dans nombre d’œuvres du répertoire musical qui sont de forme lied[44], plus généralement celle que comprennent toutes les œuvres d'une structure en trois parties (dont le scherzo Scarbo). Poème de la suspension, poème de latence, le deuxième des trois nocturnes met en mot, et en l’occurrence en musique, le sujet (au sens philosophique/psychanalytique du terme) : plus précisément, l’angoisse du sujet absorbé dans un univers d’esthétique clairement morbide. Pierre Brunel écrit au sujet du Gibet qu’il s’agit de la « plainte de poète vivant, de poète souffrant » et que « l’expression irrépressible du moi fusionne avec le fantastique » qui consiste avant tout, dans le poème, en une amorce de fantastique grâce à une hyperesthésie des sens, et plus précisément celui de l’audition :
«Ah ! ce que j’entends, serait-ce… »
Que le fantastique nimbe telle la lueur sanglante du soleil couchant cette inquiétude qui est le sujet esthétique du poème, cela ne fait aucun doute, surtout si l’on rapproche le texte d’Aloysius Bertrand des autres où la thématique du pendu est présente: dont le Cheval mort qui le précède immédiatement et où sévit le gibet comme instrument de mort, d’horreur visuelle, d’inquiétude auditive… Helen Hart Poggenburg note à propos du Cheval mort que « l’apparition du gibet est ici remarquable, et comparable à celles qui se trouvent dans l’ Heure du sabbat et le Gibet. » Elle ajoute que Ravel « devait penser à toutes ces manifestations en écrivant son Gibet ».[45]
Le Crépusculaire avec un grand C
Des trois poèmes, le Gibet est le plus troublant musicalement parlant, et correspond tout à fait à ce que Michel Guiomar nomme « le Crépusculaire » qu’il définit ainsi :
« Nous rassemblons dans le Crépusculaire tous les phénomènes analysables dans le fait réel du crépuscule ainsi que les climats qui, par référence à l’étymologie du mot, -crepurus : incertain-, peuvent s’insérer, par leurs causes, composantes ou conséquences, dans un grand concept d’incertitude. On ne saurait les citer tous mais certains corollaires immédiats de l’incertitude s’imposent : l’indécision, le doute, le scepticisme, l’attente, l’inquiétude, l’espoir.»[46].
Il précise à la page suivante que « Le Crépusculaire comme catégorie esthétique, est une Solitude de l’âme ». Il s’agit de « la part active du poète dans la lutte et le cheminement qu’il va parcourir à travers les catégories de la Mort. ». Mais la suite est encore plus intéressante par rapport à notre préoccupation qui consiste à établir une nature de lien pertinente entre le poème d’Aloysius Bertrand et la page de musique de Maurice Ravel :
« Remarquons pourtant que la poésie ne possède son pouvoir et ne livre un message transcendant qu’en se musicalisant, elle ne témoigne d’une plurivalence enrichissante comparable à celle de la musique que par les jeux de sonorités de mots et les rapports thématiques des images, par son rythme, par sa phénoménalité. »[47]
Quant à la musique elle-même, Michel Guiomar chemine en sens inverse et part de la perception, en quête de la motivation créatrice symbolisée dans le langage:
« Le véritable rapport ontologique est ici entre l’œuvre et le créateur lui-même, fait très important.[…] On voit au moins à quel niveau se situe l’équivoque qui nous préoccupe : elle n’est pas dans le climat de la signification mais dans l’origine, auteur ou univers extérieur, de cette signification. Or cette marge d’équivoque subsistera toujours au moins au concert si une analyse psychologique et technique, impossible à réclamer à l’audition, peut l’atténuer. Ce qui ressort pour notre propos immédiat, c’est qu’un équilibre entre l’auteur et son environnement, une communication audible de l’un à l’autre peut s’exprimer si, ce caractère de la musique étant reconnu, on peut dégager les grandes lignes des techniques les plus aptes à traduire les états crépusculaires de l’âme aussi bien que les climats crépusculaires agissant sur l’auteur. »[48]
Dissonance et répétition
Dissonance et répétition sont de grandes lignes de l’esthétique de Maurice Ravel tout en étant propres aux éléments du langage musical et de leurs possibles en manière d’articulation : car une dissonance peut tout aussi bien se résoudre dans un accord parfait qu’elle fait attendre, que s’affirmer en tant que telle, ce qui est le cas chez Ravel qui va encore plus loin. Car comme le remarque Maurice Marnat[49], Ravel incorpore à son écriture la dissonance[50] au même titre que l’assonance : en quoi son écriture est plus dépouillée, mais aussi plus radicale que celle de Debussy qui contourne, détourne, se réfère en fait constamment aux règles de l’écriture tonale telle qu’elle est (et toujours) enseignée dans les cours de Conservatoire : puisque, tout en permettant de comprendre comment sont écrites les œuvres du passé, elles en donnent tous les arcanes qui permettent, notamment, la transgression... Ravel l’avait bien compris, qui revint au Conservatoire parce qu’il savait qu’avec un maigre bagage de connaissances, l’originalité de son langage en germe risquait de ne pas pouvoir se développer. La dissonance est en effet une constante ravélienne, qui utilise des échelles et combinaisons de notes, des intervalles inédits. Ravel avouait aimer les « sonorités cassées » que lui offraient celles d’un piano désaccordé lorsqu’il revenait à sa maison de vacances inoccupée pendant de longs mois. Source d’inspiration, la fragilité un peu fausse de leur timbre étaient à Ravel ce qu’était à Chopin sa « note bleue ».
Il est du reste amusant de constater dans une thématique musicale récurrente, cette même dissonance dans le Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand : présente dans les poèmes Départ pour le sabbat, où « lorsque Maribas riait ou pleurait, on entendait comme geindre un archet les trois cordes d’un violon démantibulé »[51], la Viole de Gamba qui « répondit par un gargouillement burlesque de lazzi et de roulades, comme si elle eût au ventre une indigestion de Comédie Italienne » ou encore la Sérénade « symphonie discordante et ridicule » de la première strophe et didascalie. La dissonance du reste est très présente dans les Contes fantastiques d’Hoffmann parus en 1833 chez Renduel, « l’éditeur » d’Aloysius Bertrand. La folie du « maître de chappelle » inspirera d'ailleurs à Schumann ses Kreislariana. On retrouve exactement dans la Sérénade l’orchestre discordant du Chevalier Glück. Combien signifiante (et donc inspiratrice) peut s’avérer la dissonance : frottement de deux mondes sans qu’il soit possible au témoin de se positionner, comme dans le Gibet. Anomalie et incertitude. La dissonance pour elle-même est une balise du crépusculaire. Les cloches dans Gaspard sont, comme le relève Pierre Brunel, « fêlées »[52], comme dans la dernière strophe des Deux Juifs[53] :
« Et les cloches fêlées carillonnaient là-haut, dans les tours Saint-Eustache le gothique : « dindon, dindon, dormez donc, dindon ! ».
Ensuite, ce qui fascine critiques et auditeurs- et pour cause- est l’omniprésence de la fameuse « pédale de si bémol » du Gibet qui introduit et clôt le Poème pour piano qui y est tout entier « suspendu ». Sur le plan de l’audition, la dissonance de ce sib est à la fois un répulsif et une attraction : car enfin, il s’agit bien de la note et composante essentielle de l’avant-dernière harmonie, celle de l’accord de dominante, qui précède l’ultime résolution (mib mineur). Ainsi, cet élément constituant de la logique tonale des trois pièces du Gaspard de la Nuit de Ravel se veut également transgressif : Ravel l’intègre à un langage tonal dont la science est poussée à l’extrême… Jusqu’à faire entendre son contraire… Marcel Marnat a compté qu’elle était énoncée 153 fois au cours des 52 mesures. Le pianiste Gil Marcheix a obtenu 28 manières de toucher ce si bémol[54], seul ou en octaves à l’unisson, et dans les divers registres (sans toutefois dépasser le médium où il est globalement installé).
Outre cette immobilité que confère la pédale de si bémol, une recherche sur le timbre, lequel constitue un axe essentiel de la composition pour piano de Maurice Ravel, participe de cette ambiance « plombée »(Marnat), « d’un rythme de plomb » (Cortot), qui fut gravée sur les cartons de piano mécanique par le compositeur en 1920. En effet, Ravel fut très vigilant et exigeant par rapport à l’interprétation de son Gibet dont il voulait une exécution distanciée : comme détachée. Cela, semble-t-il, souligne le propos de M. Guiomar par rapport au Crépusculaire comme donnée esthétique, en regard de laquelle l’interprétation de l’œuvre peut réduire la « marge d’équivoque » entre l’état d’esprit du créateur et le résultat sonore de l’enregistrement ou du concert (concert où la présence physique de l’interprète constitue autant d’éléments de (bonne) réception supplémentaire des intentions musicales). Il y eut des dissensions entre Maurice Ravel et le pianiste et ami d’enfance Riccardo Viñes qui avait créé presque toutes ses œuvres en concert. Or, si Viñes créa finalement le Gibet salle Erard, le 9 Janvier 1909, il revendiquait pour ce second « poème » une interprétation volontairement expressionniste et affectée, sans laquelle il soutenait que le morceau risquait d’ennuyer les auditeurs. Mais Ravel lui tint tête : il souhaitait instamment un jeu « détaché ». Ironiste et éminemment romantique en cela, tout à fait « dans le ton » d’Aloysius Bertrand, il tenait à un « second degré » nécessaire à cet « exorcisme » que d’aucuns ont défini comme une catharsis purgative que la folie apparente de Scarbo a pu encourager à percevoir en tant que telle. Percevoir, mais pas au-delà d’une écoute passive et de quelque a priori qui enferment Ravel dans ce bonhomme froid et hanté malgré lui qui lutte avec bravoure contre ses spectres. Ravel a dédié son Gibet à Jean Marnold, critique au Mercure de France. Il lui explique bien entendu que la pièce lui est destinée parce que les seconds mouvements sont par convention ceux qui sont dédiés à « ces messieurs les critiques » et que, pianiste amateur, Jean Marnold ne sût être empêché dans ce second volet par la difficulté technique qui est moindre en regard des deux autres pièces. Or, Jean Marnold est en l’occurrence un critique littéraire. Cette précision est d’autant moins anodine que l’on sait que le Mercure de France a veillé à la troisième édition de Gaspard de la Nuit, en 1895.
Timbre et langage
Le timbre et l'espace sonore sont en effet essentiels par rapport à l'écriture musicale du Gibet et sont mis en exergue dès le début de la partition par un élément que jusqu’ici je n’ai pas trouvé commenté, et qui concerne la sourdine[55] : « sourdine durant toute la pièce », est-ce indiqué. L’effet voulu par l’utilisation de la sourdine est bien un timbre particulier car même si la nuance est faible depuis le PPP « pianississimo » des « grappes d’accords suspendus »[56] dans l’aigu, Ravel atteint le mezzo forte, qui normalement n’appelle pas l’utilisation de la sourdine. Il s’agit dès lors bien de la recherche d’un effet de timbre, d’une couleur « blanche », que Pierre Brunel relève par ailleurs au sujet de la phrase mélodique centrale -nous verrons en quoi elle est centrale- à la mesure de 6/4 : « un peu en-dehors, mais sans expression ».
Atmosphère où effectivement semblent l'emporter l’air, le vent, la bise et le silence éloquent : des « bruits blancs », des « mélodies blanches » telles celles que le compositeur Wally Badarou a su en créer dans sa pièce Wolves après avoir enregistré le bruit du vent, puis échantillonné pour s’en servir ensuite en tant que timbre pour sa mélodie : un « vent qui chante ».[57] A cette différence près que ce silence est ici un silence de mort et la bise nocturne, l’angoisse. H.H.Poggenburg[58] note à propos du poème de Bertrand qu’il peut être utile de le rapprocher du pastiche du Bal des pendus de Villon par Nerval : le Souper des pendus, où il est question « du vent du soir [qui] siffle à travers les os des pendus ». Mais il semble également pertinent de le rapprocher de la 3ème strophe du Cheval Mort : « la bise soufflant dans l’orgue de ses flancs caverneux ». Outre la dérision de l’image de l’ « orgue universel » de l’introduction effleurés sous la clarté de la lune par les « doigts de Dieu », des accords comme ceux qui sont égrenés dans les aiguës entre deux thèmes du Gibet de Ravel pourraient évoquer ces bruits, ces vibrations morbides dont l’air est électrisé, d’autant que Hélène Jourdan- Morhange indique dans son témoignage que ce qui intéressait Ravel lorsqu’il utilisait la pédale de résonance pour énoncer les grappes d’ accords suspendus dans les aiguës (et comme dans Noctuelles -qui sont des oiseaux de nuit) c’était de donner, plutôt que la clarté des notes, « l’impression floue de vibrations dans l’air. » … Ces accords perdus dans la résonance de la pédale qui évoluent en mouvement contraires[59], consistent dans les renversements d’un accord qui serait celui de de 9e de dominante de sibb (« double bémol » Majeur), ce qui reviendrait, sans l’armada de bémols et de doubles bémols, à du la Majeur, tonalité qui comporte trois # à la clef, antipode lumineuse ! Et en effet, Ravel nous entraîne aux confins de la tonalité, tonalité qui ne sera d’ailleurs pas résolue, au contraire : on passera d’une armure de six bémols à six bécarres, soit plus rien à la clef : ces accords frottés à l’implacable pédale de sib passent pour des clusters, soient des harmonies venus de nulle part dont la texture importe seule sans que soit rendue possible l’inscription dans une quelconque tonalité. En quoi la modernité de Ravel est absolument remarquable : car il s’agit d’une modernité dont le point de départ est poésie, atmosphère, intention esthétique (en l’occurence, le Crépusculaire).
Silence, immobilité, où « la pédale flottante des Oiseaux tristes, à son tour, est devenue rigide comme une tringle. »[60] Marcel Marnat relève la démarche poétique présente dans les Oiseaux tristes, cette seconde page Miroirs écrite en 1904 :
« Cette page volontairement statique préfigure le Gibet de Gaspard de la nuit (…) Par ailleurs, l’adjectif « triste », accolé aux symboles traditionnels de la liberté, semble relever, lui aussi, de l’esprit de paradoxe qui pointe si volontiers son nez dans l’inventivité ravélienne ».
Les pendus sont-ils des oiseaux tristes. Les dessins d’Aloysius Bertrand peut y faire songer, la stylisation de Ravel, également.
Structure en arche et effets de miroir
Poussée à l’extrême, la stylisation dans le Gibet est architecturale. La pièce musicale est en effet en forme d’arche –où les thèmes sont exposés, deux fois, de manière symétrique qui est certes la figure de l’arche gothique mais également une métaphore du miroir- ainsi que le montre Makis Solomos, et ainsi que nous nous proposons de la détailler :
Thème 1 : fondé sur un accord de 9ème fondamentale sur tonique (mib mineur : tonalité du morceau) : dans les graves, énoncé aux deux mains deux fois dans une même phrase musicale. Ce thème procède d’ailleurs en (enchaînements d’) accords, dans une écriture manifestement verticale : mes. 3 à 5
Thème2 : construit sur les mêmes notes différemment altérées, sur des rythmes et dans un ordre presque inversé (presque en miroir) : doublé à la main gauche séparée de la droite par une simple octave dans le médium/aigu : se différencie du thème par son caractère plus particulièrement mélodique, « horizontal » : énoncé lui-même deux fois, séparées par une mention unique du thème 1
-énonciation à l’unisson simple : mes.6-7
-énonciation dramatisée par une doublure à la tierce, également aux deux mains : mes.10-11
Thème 3 : construit également sur une répétition du thème avec un triolet particulièrement « hispanique » : il assure la continuité dramatique du texte musical avec des accords de 4 sons à chaque main, le registre à la fois plus grave (à gauche) et plus aigu (à droite) implique une amplitude sonore forcément élargie.
Motif laconique sur deux éléments de langage qui consiste en la superposition, deux fois, d’un motif descendant dans les graves en un intervalles de quartes : sur deux quartes, d’ailleurs, à la main droite superposées à deux quintes à gauche : mes. 15 et 16. Est remarquable un changement de mesure : 3/4
Réitération du thème 3 : mais, cette fois-ci, transposé (les thèmes précédents étaient réitérés dans la même tonalité de lab mineur (présence de la note sensible[61] sol bécarre) : mes.17-19
Grappes d’accords suspendus : dans les aiguës, en mouvement contraire dont il est parlé plus haut : nuance PPP et "très lié/un peu en-dehors" dans la résonance de la pédale de droite du piano, dans un frottement perpétuel perpétré par cette pédale de résonance avec l’irascible « pédale de si bémol »… : mes.20-22, réitérées transposées (entre deux un changement d’armure où les 6b de mib mineur disparaissent), ce qui donne l’impression d’une réitération encore « plus » aiguë à l'audition: mes. 23-25
Réitération du motif laconique : mes.26-27: répété deux fois sur une dissonance de 7e majeure où mi bécarre et mi # se frottent, ainsi que le ré (seconde note) avec la basse (do#). On peut dire que ce motif fait office de conclusion : avant la surenchère de la répétition du thème 3 comme vu plus haut, et ici en l’occurrence à la fin de cette première partie qui consiste dans l'exposition de thèmes et de motifs, et que suit immédiatement le chant central…
Chant central : pp, « un peu en-dehors, mais sans expression », mes. 28 à 34 incluse. Il s’agit, au sens sonore du terme, d’une sorte de « voix blanche » (Pierre Brunel dit « mélodie blanche »), un chant crépusculaire. C'est la plus longue mélodie de la pièce exposée en deux temps, la réitération amenant une doublure à l’octave, plus aiguë et plus expressive, avec un crescendo/décrescendo. Pierre Brunel se demande d’ailleurs s’il ne s’agit pas du soupir du pendu lui-même encore sensible, que les agaceries des éléments qui l’agressent à petite échelle tourmenteraient (l’escarbot qui passe et lui arrache un cheveu, l’araignée qui tisse sa toile autour de son cou). Le pendu serait alors une incarnation littéraire (et picturale : le poète les a maintes fois dessinés) de la voix d’Aloysius Bertrand lui-même, de sa « voix discrète », « de ce que Verlaine a appelé « l’âme qui se lamente » . Il ajoute que seule l’interprétation de Claudio Arrau[62]a pu ainsi détimbrer la mélodie :
« On croit entendre un son plaintif, mais il se situe en-deça de la plainte »[63].
Marcel Marnat nous indique que les enregistrements de Ravel pour piano mécanique, à l’atmosphère « plombée », ne sont pas mal non plus…[64]
Peut-être la notion de Crépusculaire cède-t-elle, ici et selon la logique de Michel Guiomar la place au Lugubre, une autre grande catégorie esthétique qui possède ses caractéristiques propres : peut-être l’inquiétude cède-t-elle dans le saignant éclairage à l’angoisse inexprimable, inexprimable que la phrase « sans expression », c’est-à-dire atone, débarrassée de toute intention d’intensité dans l’interprétation, met en exergue… Cela rejoint tout à fait le propos de Michel Guiomar selon lequel l’interprétation peut amoindrir, dans la performance sonore du Crépusculaire en musique, la marge qui séparerait l’intention de l’auteur de cet évènement fantastique que constitue l’appréhension sonore d’un phénomène dont les mots ne disent rien…
Thème 3 : avec son triolet hispanisant, il vient comme interrompre la « mélodie blanche » du chant central. Non réitéré cette fois-ci mais au discours développé, le thème devient mélodie à proprement parler. Notons qu’il correspond à un retour de l’armure de la tonalité d’origine (6 bémols à la clef). Mes. 35 à 40
Grappes d’accords suspendus… : mes. 40-41
Thème 2 : énoncé une fois seulement…mes. 41 à 43
…Grappes d’accords suspendus (bis) : et une octave en-dessous : mes.43-44
rappel du motif laconique (mutations) : intervalle descendant sur deux notes, progressivement réduit , de la mesure 45 à la mesure 48, puis répété tel quel mes. 49 et 50, superposé à l’...
...Ultime retour du thème 1 dans les graves, avec une variante de son avant-dernière note qui permet un dernier intervalle descendant (et non plus ascendant), ce qui peut être signifiant.
La pédale de si bémol est stable durant toute la pièce, à la fin comme au début, seule puis omniprésente quel que soit le discours qu’elle accompagne au sens littéraire, littéral, mais également spécifiquement musical du terme (elle constitue notamment le seul élément harmonique qui « supporte » le chant crépusculaire central). Elle constitue un axe de symétrie en trois dimensions (plus, si l’on se réfère aux paramètres du son, d’autant que cette pédale qui contamine et harmonise se trouve dans l’extrême grave des basses durant toute la dernière page de la partition –soient les 13 dernières mesures, et soit le quart de la pièce-). Elle donne à la pièce tout son volume dramatique… Motif minimaliste sur une seule note, c’est sur sa répétition que repose l’édifice savant de la structure en arche du Gibet.
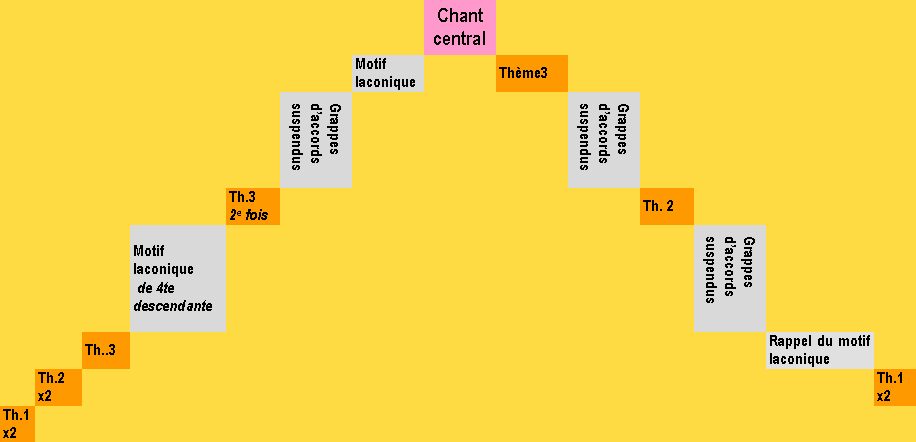
On peut remarquer que le thématique est, dans son retour inversé, dilué, alors que l’exposition procède rigoureusement. Il peut être intéressant d’autre part de distinguer ce qui tient du thème (structurant et reconnaissable : symétriquement réexposé), du motif : balise sonore dont une propriété particulière marque la spécificité et qui ne peut procéder que dans la répétition, dont la seule variation possible est la transposition. Enfin le mélodique pur (chant central) qui pourrait être considéré comme un aboutissement et non un élément de construction de la pièce a priori : au contraire, son existence semble procéder du déroulement lui-même :comme si, nourri des éléments qui l’avaient amené à se manifester, il en procédait naturellement et n’était pas prédéterminé (ce qui est une idée valide dans le cadre d’une réflexion sur le rapport entre l’œuvre et le geste créateur, et cela qu’il s’agisse de musique ou de poésie). La pédale de si bémol enfin, omniprésente, nimbe, préfigure, accompagne, hante, dissimule la structure du morceau en tant que telle et obsède l’écoute.
Ravel utilise d’ailleurs dès la 12ème mesure et jusqu’à la fin de la partition une troisième portée[65] . Il a recours, comme l’a fait avant lui Liszt, à ce procédé même au cours du morceau lorsqu’il veut dissocier visuellement, à l’attention de l’interprète, les plans sonores (ainsi dans Ondine le grand crescendo sur pédale de do#[66] où la basse bénéficiait d’une troisième portée). Elle est couplée par une accolade à la portée du bas, quitte à être habitée par un silence lorsqu'elle ne comprend pas de musique. Dans le Gibet cette troisième portée permet de mettre en valeur les doublures thématiques, grappes sonores en mouvement contraire, tandis que la pédale de sib occupe la portée centrale et durant toute la fin, la basse… Cet effet de mise en page n’est pas sans rappeler les « blancs » souhaités pas Aloysius Bertrand, ni le soin avec lequel Ravel édite lui aussi ses partitions en prenant le soin de garder une place pour le poème en face de la première page de musique …
Pour une écoute active, le tableau ci-dessous avec les différents repères audio permettront la reconnaissance à l’audition balisée, de chacun des thèmes et motifs dans leur exposition et réexposition: l’écoute globale s’en trouvera davantage orientée. Comme support, l’interprétation du pianiste Jean-Efflam Bavouzet[67].
|
Eléments structurants |
Exposition1 |
Exposition2 |
Mélodie centrale |
Réexposition1 |
Réexposition2 |
|
Thème1 |
0’13-0’36 |
0’52-1’05 |
3’13-3’43 amplifié 3’44-4’10 |
5’40 4’53-5’06 4’10-4’43 5’13 à partir du fa b accentué de l’appogiature intervalle réitéré 5 fois |
|
|
Thème2 |
0’37-0’51 |
1’06-1’20 |
|||
|
Thème3 |
1’21-1’42 |
1’55-2’19 |
|||
|
Motif laconique :4te |
1’43-1’55 |
2’59-3’12 |
|||
|
Grappes |
2’19-2’39 |
2’39-2’59 |
4’43-4’53 |
5’07-5-13 |
|
Deux remarques découlent d’une telle analyse minutée : les éléments d’une part s’enchaînent les uns aux autres lorsqu’ils ne sont pas entre les différentes parties séparés par la pédale de si bémol seule. D’autre part la réexposition des thèmes offre une plus grande présence des motifs, dont la dernière occurrence des grappes sonores et de l’intervalle « laconique » superposés à la toute fin ainsi que celui du thème 3 (dans le sens d’un pathétique palpable). Par contre les autres thèmes ne sont pour eux énoncés qu’une seule fois lors de leur réexposition: « rappelés », pourrait-on dire. Le tout selon un sens de l’équilibre de l’œuvre quasi mathématique puisque l’absence de la seconde occurrence des thèmes, celle qui n’est pas répétée lors de la réexposition, a cédé sa place au chant de mort « un peu en-dehors mais sans expression » placé à l’exacte centre du Gibet.
Métaphore de son climat crépusculaire qu’elle reflète (miroir), et auquel elle renvoie (éternel retour), ou encore enclose sur elle-même- et en cela d’une autarcie mortifère dont l’essence est de s’annuler au fil de son développement- il est par ailleurs possible de rapprocher cette structure en arche du Gibet de Maurice Ravel de celle du recueil de poèmes d’Aloysius Bertrand: selon six thématiques présentes dans l'introduction qui correspondraient à chacun des six livres jusqu'à celui, le dernier, de la disparition. La structure en arche évoque également, surtout dans ce cas de figure où la proportion 50/50 est quasiment parfaite, la symétrie du miroir et par association d’idées, les Miroirs de Maurice Ravel dont Marcel Marnat souligne le fait qu’ils préfigurent à bien des égards son Gaspard de la Nuit : les Oiseaux tristes, mais également le fameux Alborada del gracioso qui anticipe, notamment, l’esthétique de Scarbo.
Scarbo : un romantisme digital
Espagne et Italie
D’aucuns critiques veulent voir dans ce mot d’« exorcisme », que Ravel a employé en particulier à propos de Scarbo mais n’a pas développé, une sorte de manquement à l’attitude distanciée exceptionnel chez le compositeur : manquement auquel il aurait cédé presque à regret. Or, si d’un point de vue esthétique la notion de « distance » se tient généralement dans la mesure où elle permet la maîtrise complète de son art et de sa démarche, Gaspard de la Nuit est une œuvre suffisamment fidèle à la littérature de laquelle elle se réclame explicitement pour ne pas avoir établi avec cette dernière une relation très construite. Maurice Ravel a toujours pensé, élaboré le rapport de sa musique avec la littérature. Il s’est ouvert clairement, peu de temps avant Gaspard, de la nature de sa relation au sujet littéraire auprès de Jules Renard, devant le scepticisme de ce dernier quant à l’intérêt d’une mise en musique de ses textes, et, surtout, son agacement du choix circonspect de Ravel des pièces élues pour leur mise en musique (Ravel en choisit fort peu). Jules Renard rapporte le court entretien qu’il eut avec Ravel dans son Journal :
« (…)
Je lui dis mon ignorance et lui demande ce
qu’il a pu ajouter aux Histoires naturelles.
-Mon
dessein n’était pas d’y ajouter, dit-il,
mais d’interpréter.
-Mais
quel rapport ?
-Dire
avec la musique ce que vous dites avec des mots quand vous
êtes devant un
arbre, par exemple. »
Ce propos de Ravel est très éclairant dans la mesure où il n’oppose ni ne place en tant que miroir l’un de l’autre la littérature et la musique, mais au contraire les considère dans une perspective propre à chacun du pouvoir « dire». Ce qui n’empêche pas Ravel d’avoir mis en musique les textes, sans doute rares, qui se prêtaient à une telle démarche, tout en en ayant fait quelque chose nouveau, d’original : une œuvre musicale à part entière d’après un œuvre littéraire. Cela exclut la notion passe- partout, un peu bateau et plutôt vide de sens de « transposition ». Le Dictionnaire d’esthétique d’Etienne Souriau[68] ne s’y est pas trompé, qui cantonne la notion à son domaine propre : c’est-à-dire exclusivement musical, et dont les synonymes sont l’« arrangement » et l’« adaptation » dans l’acception la plus large du terme… soit un acception forcément étroite en regard des trois poèmes de Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand qui font face chacun à la partition des trois poèmes éponymes pour piano de Maurice Ravel. Gérard Dessons écrit de la même manière dans son article « le rythme et les arts : les ressorts d’une arnaque »[69] sur l’aporie d’un autre mot passe-partout, en l’occurrence le « rythme », lorsqu’il est appliqué à l’art : « L’interrogation sur la notion floue de « rythme » dans des champs disciplinaires différents montre la recherche de dénominateurs communs entre les arts qui est forcément un « réduction conceptuelle ». Gérard Dessons rappelle que pour P. Sauvanet et la philosophie de l’art, « esthétiquement parlant cela veut dire à la fois sensiblement et artistiquement ». « Sensiblement » : la notion de perception est donc essentielle. En aucun cas elle ne saurait se résoudre dans la relation entre deux arts, qu’elle dépasse largement. En cela le « rythme des flots » ne peut être qu’une métaphore, souligne G. Dessons… Et pour la question du langage des mots et du langage des sons, il rappelle Mallarmé: « la musique du langage n’est pas la musique de la musique ».
Partant, peut-être cet « exorcisme » consiste-t-il simplement pour le compositeur dans le besoin d’un retour aux sources nourricières : les textes romantiques de sa jeunesse, dont il prévaut en général de se défendre lorsque l’on est inscrit dans les lumières d’un temps en rupture… La préoccupation du texte et la référence aux sources sont de toutes manières en ce début du 20e siècle générales à l’heure où le poème symphonique, dont le « programme » est l’avatar de la littérature, se meurt. On évalue la valeur du livret des opéras: Pélléas et Mélisande, Daphnis et Chloé...Le mysticisme dépouillé du premier Satie et la grande désespérance du deuxième sont encore dans les pièces pour piano les plus humbles maquillés par du texte, en l'occurence par la dérision de titres qui choquent le public. Une poésie de la dérision et de la pudeur, de la dérision par pudeur souvent que Cocteau qualifie de « charmant ridicule » dans le Coq et l’Arlequin et auquel il oppose le « formidable ridicule » des livrets de Wagner. Les titres de Satie inspireront d’ailleurs Ravel pour nommer ses Sites auriculaires.
La connaissance par Ravel d’Aloysius Bertrand et son intimité avec les poètes depuis son plus jeune âge est insuffisamment connue pour ne pas être ici soulignée avec insistance. Il existe trois versions rapportées par Marcel Marnat quant à la connaissance précoce que Ravel a forcément eue de Bertrand. La première concerne son ami Riccardo Viñes, le pianiste surdoué qui créa presque toutes les œuvres de Maurice Ravel jusqu’à la dissension du Gibet, mais qui fut séduit par les Oiseaux tristes des Miroirs, à lui dédiés, et qu’il défendit bec et ongles si l’on peut dire. Viñes confie dans son journal qu’il possède l’un des exemplaires de l’édition originale de Gaspard de la nuit, version qu’il se serait procuré lors d’un voyage à Londres. Marnat développe :
« Cette âme si volontiers engloutie, cette curiosité fragile de Ravel devenu jeune homme (…) Viñes s’emploie, depuis toujours, à en accélérer les ferveurs et c’est une perpétuelle circulation de livres, volontiers choisis parmi les pré- et post-symbolistes, d’Aloysius Bertrand à Villiers de l’Isle-Adam en passant par Baudelaire et Mallarmé, Edgar Poe (pour lequel Ravel dessine des illustrations en 1892(…) ».
La deuxième possibilité de cette connaissance précoce d’Aloysius Bertrand est la réédition du recueil au Mercure de France en 1895, soit suffisamment tôt dans la vie de Maurice Ravel pour qu’il ait eu la possibilité de l’avoir compulsé avec passion avec ses amis les Apaches, hommes de lettres autant que musiciens qui se réunissaient jusque tard dans la nuit, et jusqu’à ce que le tapage nocturne du piano et des déclamations aient forcé le groupe à se réunir ailleurs. La troisième version, la plus connue car la plus romanesque, est celle de Tristan Klingsor, l’un des Apaches[70] dont l’oncle libraire possédait un exemplaire, et dont son neveu eu recopia « bien des pages » auxquelles le compositeur eut accès.
Du reste, Ravel avait aussi la sensibilité des eaux-fortes, des dessins (on sait donc qu’il dessina des illustrations pour Poe) et une grande admiration pour Jacques Callot et le grotesque dont il a parfaitement saisi l’inquiétante drôlerie mise en musique dans sa quatrième composition des Miroirs, Alborada del gracio, qui présente l’aubade d’un vieux beau rejeté par sa belle, inspiré des figures grotesques de Callot. Dans ce scherzo, comme dans Scarbo d’ailleurs, en trois parties, la pièce revisite les ridicules mais également une couleur très « Espagne et Italie », une couleur exotique particulièrement romantique parce que toute en couleurs et évocations d’un orient littéraire. Cet exotisme livresque est bien particulier à Maurice Ravel parmi les autres compositeurs de son temps et balise son œuvre entière de diverses manières : hispanisme dont il serait assez vain d’après Marnat de chercher l’origine dans les origines basques de sa mère et la propension qu’elle pouvait avoir de chantonner des zarzuellas (airs d’opérette espagnols). En effet, la manière particulière et diverse dont Ravel colore sa musique d’hispanisme doit sans doute bien davantage à l’amitié précoce qu’il entretint avec Riccardo Viñes, et encore à son professeur de piano particulier d’origine espagnole Riccardo Riera[71] qui l’aurait initié des années durant au répertoire de la musique espagnole et semble avoir suffisamment compté pour que Maurice Ravel lui soit toujours resté fidèle.
L’hispanisme de la musique de Ravel peut être aussi dans les œuvres qui le « programment » ouvertement ostentatoire, voire parodique, mais il s’agit toujours d’un « hispanisme rêvé » selon Christophe Looten[72] comme dans la Habanera ou encore le Bolero qui adopte un tempo deux fois plus lent que celui de la vraie danse espagnole classique et en cela « suffit à éloigner l’exemple espagnol pour n’en retenir que l’archétype ». Il peut encore être présent sous les couleurs d’un exotisme suggéré qui semblent appartenir à l’écriture ravélienne en propre lorsqu’elle traduit une poétique plus générale : le grotesque, le merveilleux, et donc constituer un attribut romantique comme dans l’Alborada, ou encore la préfiguration du grand crescendo lyrique de Ondine. Ansi la réitération sensuelle du thème d’Ondine juste avant la déferlante de tierces et secondes dans le passage central[73] : les notes du thème sont partagées en alternance aux deux mains, ce qui est une gageure technique mais également d’une grande sophistication « chorégraphique » du point de vue de l’interprétation pianistique : tout en accords arpégés et comme projetés spatialement autour de la mélodie, dans une nuance pianissimo en staccato[74]. C’est plutôt ici que se trouve l’Ondine séductrice, l’Ondine « tentatrice et nue » d’Alfred Cortot, et ici davantage que dans le prélude de Debussy : parée de ses arguments sonores et gestiques d'un l’enchantement des plus sulfureux.
Et s’il y a une filiation certaine entre le piano de l’Alborada et celui de Scarbo, il ne fait aucun doute pour Maurice Marnat que le sujet de Alborada est issu du recueil de Bertrand : le vieux séducteur, aux « beaux rubis sur le nez » dont le passage central du scherzo exprime par ailleurs le pathétique (Scarbo, autre scherzo, n’échappe pas non plus à l’expression d’une souffrance entre les deux intrusions du gnome maléfique et multiforme). Cela semble d’ailleurs être le cas pour nombre des œuvres ravéliennes:
« Ce [même] chaos introduit dans la continuité de sens, c’est Noctuelles. L’Alborada dérive probablement de la Sérénade, peut-être même du Raffiné, de même que la Messe de minuit crée un dramatisme suspendu très proche de la Vallée des cloches. Si le Grillon fut choisi parmi tant d’Histoires naturelles, c’est peut-être parce que, dans Gaspard de la Nuit, son innocence devenue muette condamnait la Salamandre : ainsi le double pathétique imprimé à la fin du texte de Jules Renard peut-il apparaître comme un écho offert à la prose de Bertrand. ». [75]
On constate que deux niveaux d’une cohérence esthétique qui toujours renvoie aux poèmes écrits, se croisent chez Aloysius Bertrand et Maurice Ravel : à travers une même distance ironique par rapport à leurs sujets dont ils débordent le sens, et d’autre part une parenté entre les œuvres de Ravel antérieures à Gaspard de par leurs éléments thématiques, leur écriture ou leur tempérament (particulièrement dans Miroirs) et Gaspard de la nuit lui-même, ce dernier pouvant notamment en être considéré comme la mise en œuvre plus noire et plus radicale. Marcel Marnat rêve encore d’autres perspectives dans ce sens :
« Si la Barbe pointue lui rappelait bien trop les Tableaux d’une exposition, la tentation fut grande sans doute d’illustrer les Cinq doigts de la main par une série de cinq études à la manière de Chopin. Mais non : conjugué à l’angoisse stagnante qui règne dans l’appartement des Ravel, le climat d’égarement laissé par Boris Godounov[76] le mène à des représentations emblématiques »[77].
Ainsi pour Marnat Ondine incarne l’amour inutile, le Gibet, la mort planant, et Scarbo « les fureurs de la folle du logis », sorte de Margot l’enragée de Breughel. Pour Marnat il s’agit entre d’une parenté poétique entre l’œuvre du compositeur et celle du poète en regard de ces « dé-personnalisations » qui annoncent les recherches de Ravel :
« langage discontinu, dérisoires citations de proverbes ou d’expressions populaires, autant l’ingrédients qui signifient les choses tout en les objectivant ou les niant, façons obliques qui n’étaient pas pour déplaire à l’esprit paradoxal du musicien. ».
Scarbo
paroxystique :
analyse de Scarbo
Les trois pièces du Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel sont, ainsi que l’affirme Pierre Brunel, des nocturnes[78]. Leur lieu est la nuit, condition sine qua non de ses apparitions et de ses hantises. Issue du livre « la Nuit et ses prestiges », Ondine n’appartient pas aux catégories esthétiques de la mort telles que les définit Michel Guiomar[79], du moins en tant qu’œuvre musicale. A peine une inquiétude à la fin, et encore, à la lecture seule du poème : parce que le rire intriqué au pleurs est une image inquiétante de folie : mais dans l’élément liquide de Ravel, il faut l’analyse pour déterminer l’ambiguïté d’une telle apparition (fruit de l’imaginaire, de l’imaginations, ou apparition fantastique ?), d’une telle créature (amoureuse évaporée, fiancée éperdue et prête à tous les dons, manipulatrice a priori?). Pour le Gibet, ainsi que nous l’avons évoqué la catégorie du Crépusculaire est immédiate, et la profondeur de ses basses, l’obsessionnelle note de si bémol sur six bémols, tend à l’audition seule, au Lugubre dont les procédés à l’analyse (verticalité, nuances) conjuguées aux indications intertextuelles laissent présager le contraire de la vie…
Pour Scarbo Ravel, comme Aloysius Bertrand, aborde la démesure. Marcel Marnat parle des « fureurs de la folle du logis » en tentant de qualifier les affects mis en jeu dans la création de ce morceau paroxystique. Le fantastique est ici avéré, ou alors il s’agit de folie : dans tous les cas le sens étymologique de la fantaisie [phantasia] est à son comble et ce comble n’a rien de dépaysant par rapport au monde de l’angoisse. Scarbo appartient à la catégorie de l’Infernal dans toutes les déclinaisons de ses sens- et des sens : vision, ouïe, sensations de morsures… Or tout cela est rendu par la pièce du compositeur, en regard du texte encore une fois, dont l’expressionnisme est ici à son comble. Pianistiquement, la filiation entre Scarbo et l’Alborada est frappante et d’autant plus pertinente lorsque l’on présume que pour les deux morceaux Ravel s’est inspiré du recueil d’Aloysius Bertrand : deux scherzos à la technique hautement digitale qui n’est certes pas sans évoquer la Toccata du Tombeau de Couperin, toute en notes répétées et staccato pour leurs parties extrêmes. Il existe en outre un pathétique avéré dans la partie centrale de l’Alborada, dont on retrouve la trace dans le lyrisme effaré du premier thème de Scarbo et le flottement qui suit le bouillonnement sonore dans les extrêmes graves au centre de la pièce.
Scarbo de structure ternaire, épouse la structure ternaire du poème : à une simple question de proportions près! Il s’agit en effet d’un scherzo : une pièce de caractère dansant (ici acéré) de tempo vif, en trois parties : structure musicale romantique dont Ravel se sert et qu'il détourne au profit d’une écriture du morcellement, de la variation en négatif, car comme le souligne Jankélévitch « Ravel y étrangle presque tout développement ». Et si Pierre Brunel se penche dans Basso Continuo sur l’art de la variation, on peut bien ici rapprocher le sens de cette variation musicale négative : toute en morcellement, en décomposition, en déformation des thèmes ou parties du thèmes comme cela est audible dès l’introduction qui est le début de l’incursion, dans le registre grave des trois notes énoncées comme suit:

Ravel aurait écrit «quelle horreur » sous les trois notes suivies de leur trille/trémolo[80]. Deux critiques de son temps on en déduit qu’elles correspondaient au programme des trois syllabes « quelle hor-reur »[81]. Pourquoi pas. Mais il est important de souligner que ces trois notes deux fois réitérées à l’unisson dans les graves correspondent à la tête du premier thème du scherzo, quoique la quinte aboutissant à la troisième note soit dans le thème même « mutée » en 7ème, puis disparaisse pour laisser dans sa forme la plus réduite le thème 1 : soit l'intervalle de seconde mineure initial (qui constitue le plus petit intervalle tonal existant) et que l’on peut considérer si l’on veut comme un troisième motif indépendant des deux thèmes : cependant, précédé d’un demi-soupir, il semble lié au thème 1 dont il serait le double, écho des trilles/trémolo qui lui sont apparentés (utilisant la seconde mineure également et lui succédant immédiatement). Cette forme d’annonce introductive constitue donc une amorce d’irruption en soi, qui consiste a priori dans le morcellement. Pour remarque, le trémolo serré, incisif de Scarbo est constitué des mêmes notes que celui d’Ondine dans la seconde partie de son thème.
Le premier thème, sorte de valse romantique exacerbée à la rythmique répétitive qui pourrait évoquer le primitivisme du Sacre du printemps est en effet une bacchanale nocturne du toton, avec une grande amplitude dans la tessiture et une densité inattendue. On peut noter les couleurs hispanisantes de cette sorte de bacchanale démoniaque telle qu’elle est harmonisée, avec ces intervalles particuliers et renversables de seconde mineure et de 7ème augmentée et qui rappelle effectivement Alborada del gracioso. Elle n’est en effet pas développée au sens conventionnel du terme (dans le sens de la dilatation) mais au contraire maintes fois interrompue, greffée, resserrée : et ces multiples interruptions « montrent » ce qui dans le texte tient du visuel. Et si, comme le souligne Helen Hart Poggenburg, Ravel a forcément lu tous les poèmes se rapportant à la créature Scarbo : le Nain, la Chambre gothique, le Fou, Scarbo du Troisième livre des fantaisies, Pierre Brunel relève que « le nain et le fou se confondent dans le second Scarbo »qui a donné son titre à la pièce de Ravel. Le morcellement dans un composition, un morcellement qui fait œuvre, rappelle la composition poétique autour d’autant de thématiques, emblèmes, créatures récurrentes dispersées dans le recueil cohérent de poèmes. Par ailleurs, « La brièveté des proses de Gaspard de la nuit est comme une mimesis du fragment » selon Pierre Brunel. Certes,
« Ravel préfère la grande fresque sonore. Mais le processus créateur, ou re-créateur, n’est pas différent »[82].
L’apparition du second thème, « oxymore musical » du premier, surgit aussitôt à la suite du premier et prend la place de ce dernier, mêlé à diverses variations ou plutôt « anti-variations » : car elles déforment la tête du thème 1 mentionnée ci-dessus qui surgit alors de manière très figurative, avec des sauts d’intervalles et des écarts de tessitures. Le développement ou « anti-développement » mêle de manière bien conventionnelle deux éléments thématiques mais diffus et protéiformes à l'image du nabot railleurs, menaçant, torturant, aux gesticulations d’insecte qui occupe l’espace de la pièce dans sa largeur, sa longueur, et la maison du grenier à la cave. Dans le temps, la dimension de répétition obsessionnelle et mortifère est rendue au sens propre par le procédé de notes répétées en staccato forcément reconnaissable, d’autant que l’interprète est sensé les jouer « un peu marquées » :

René Tranchefort quant à lui remarque au sein de Scarbo « l’abondance des point d’orgue »[83] dans cette écriture de la discontinuité, de la rupture, du chevauchement des éléments les uns par les autres comme de l’âme du narrateur
« Où est ton âme ? que je chevauche ? »[84].
La pause musicale centrale existe cependant, et épouse en ce sens la structure du poème mis en musique :
« Le croyais-je alors évanoui ? ».
En effet, après deux occurrences du premier thème dans sa déclinaison lyrique opposé au thème 2 farouchement tressautant, le thème 1 est contaminé par le second qui se greffe à lui comme « le lierre dont par pitié se chausse le bois » du Gibet et devient une sorte de valse pathétique, hybride et détraquée. Puis il se réduit pour revenir aux trois notes suivies de leur trémolo de l’introduction.
Puis c’est « silence » du passage central… Ou, plutôt, les moyens de la musique traduisent la menace de cette fausse trêve silencieuse car si « le musicien ne dispose que de sons » comme le dit Pierre Brunel, elle sait aussi jouer des silences : qu’il s’agisse de respirations, de silences musicaux, de points d’orgue, de tout ce qui lui permet d’articuler son propre discours. Mais outre ces moyens stylistiques qu’offre la musique, elle trouve pour elle d’autres moyens qui lui sont propres pour ménager cette parenthèse centrale, ce bref répit : un grouillement dans les extrêmes graves rendu de manière exceptionnelle par le pianiste Pogoleritch[85] s’élève et redescend en élargissant progressivement sa tessiture en arpèges brisés qui évoquent la fluidité d’Ondine : et on retrouve ce thème 2, si acéré lors de son exposition, dilué en augmentations[86] dans une atmosphère onirique: en vagues arpégées sur une pédale de ré bémol qui comme dans le Gibet traduisent un statisme, une atemporalité crépusculaire puisque la hantise n’a pas de fin et que le répit ne pourra être que de courte durée. Ensuite elles se resserrent en vagues chromatiques accelerando, dans un crescendo progressif où la tessiture dans les deux extrêmes du clavier participe du registre apocalyptique et donne d’un point de vue proprement spatial au monstre un espace maximum, dans lequel il peut se déployer.
La fin est rapide et laisse hébété par la brutalité de la disparition sonore comme si rien n’avait existé : Scarbo n’était qu’une « apparition dérisoire » (Alfred Cortot).
|
Eléments d'analyse |
Version de Pogorelitch (cf note 23) |
Version de Bavouzet[87], « version sécurité » sur CD |
|
Introduction : tête du thème 1, deux fois dans les graves suivi de son trémolo dans les aiguës |
Réitéré la seconde fois à 0’22 Epigraphe : « Il regarda sous le lit, dans la cheminée, dansle bahut ;-personne » |
0’19 |
|
Thème 1 déployé |
0’48 |
0’58 |
|
Thème 2 plusieurs fois énoncé |
1’00 |
1’10 |
|
Variations successives du thème 2 (sur notes répétées) |
1’23 « que de fois » |
1’36 |
|
Thème 1 |
1’31 |
1’45 |
|
Mélange et superposition des deux thèmes dans leur forme la plus minimale : la seconde pour le thème 1(à moins de l’interpréter comme un troisième motif), les notes répétées pour le thème 2 « (anti) développement » en morcellement, progression dramatique en crescendo |
1’38 |
1’53 |
|
« que de fois » |
|
|
|
Développements multiple du Thème 2 , transpositions |
2’32 « que de fois » |
2’53 |
|
Thème 1 sur sa seconde (ou motif de seconde) « contaminé » par le thème 2 : notes répétées en staccato |
2’54 « pirouetter sur un pied et rouler par la chambre » |
3’20 |
|
Thème 2 |
3’01 |
3’29 |
|
Thème 1 ou motif de seconde |
3’06 |
3’36 |
|
Grande valse du thème 1 où se greffent les notes répétées du thème 2 |
3’26 |
4’00 |
|
Retour à l’introduction avec trémolo grave (prémisces du grouillement menaçant central) |
4’04
« Le croyais-je alors évanoui ? » |
5’07 |
|
Grouillement central dans les extrêmes graves sur le trémolo qui suit la tête du thème 1 |
5’05 |
6’10 |
|
Fluidité évanescente où revient le thème 1 : jeu d’alternance avec le motif du trémolo qui lui est couplé |
5’38/trémolos/6’03 « le nain grandissaitentre la lune et moi » |
6’32/trémolos/7’00 |
|
Vagues chromatiques |
6’24 |
7’16 |
|
Secondes tressautantes du thème 1, en crescendo et densification |
6’57 |
7’45 |
|
Thème 1 intégral |
7’57 |
8’59 |
|
Thème 2 |
8’05 |
9’08 |
|
Thème 1 |
8’19 |
9’26 |
|
Fin fulgurante |
« et soudain il s’éteignait » |
|
Le langage musical semble dans Scarbo constituer une sorte de métonymie de ce que la musique exprime (et qui constitue le tissu thématique du poème) : ainsi la répétition, avec l’anaphorique « que de fois » qui peut être relié au langage rythmique et mélodique de la répétition : les notes répétées. De même la variation dans les manifestations physiques et la manière dont est perçue l’intrusion de Scarbo, dont Pierre Brunel remarque que « la structure du poème établit l’ordre des sensations (entendu, vu…) » : la musique induit évidemment une perception forcément sonore, mais qui peut permettre le visualisation grâce à la variation musicale d’un thème ou d’une partie de ce thème. Tout dans la structure : microstructure (thèmes) et macrostructure (la forme de la pièce, qui permet le retour) met en scène cet « implacable recommencement ». Cependant, parallèlement semble exister une dramaturgie dans la suite d’évènements musicaux reconnaissables et procédés pianistiques spécifiques, qui utilisent telle partie du clavier, appréhendent tel mode d’articulation dans le jeu pianistique, épousent tel tempo : une dramaturgie dans l’écriture pianistique qui suit aussi la structure du poème (sans les proportions, le temps musical étant évocation d’un moment qui peut être un déroulement, comme une permanence). Si Scarbo est considérée à juste titre comme la pièce de Gaspard de la nuit qui impose la plus grande difficulté technique, comme un « compendium de la technique moderne du clavier et des possibilité du virtuose», cette difficulté est au service d’une interprétation poétique voulue par Ravel, avec toute la variété d’approche que cette interprétation suppose.
On remarquera également que la notion d’unité des « trois poèmes » qui font œuvre unique est respectée par le mouvement rapide opposé au Gibet qui lui précède, après une Ondine dont le tempo est certes indiqué « lent », mais que la densité d’écriture peut tout à fait permette de percevoir comme un premier mouvement "moderato". De ce point de vue encore l’exploitation inédite de la technique instrumentale déjà envisagée ainsi- en moins figuratif- dans le Tombeau de Couperin ainsi que sa gageure poétique, se veulent inscrire l’oeuvre dans une filiation : celle du répertoire pour piano. Le piano comme voie/voix de l’expression poétique. Cette distance ironique de l’artiste au produit (in)fini de son œuvre, cette conscience qu’il n’est jamais en musique enclos sur lui-même et doit être pensé, s’il se réclame d’un sujet référent, par rapport à la relation nécessaire à ce dernier (et cela même lorsqu’il brasse comme ici les noirceurs et les hantises les plus fuyantes) semble, en-dehors même du lien aux textes d’Aloysius Bertrand, une attitude éminemment romantique qui la singularise.
« Poèmes…
L’attirance
pour le littéraire des œuvres musicales
de Maurice Ravel
–en particulier celles écrites pour le
piano - n’est pas qu’une
sensibilité personnelle au
« poétique » dont
s’est réclamé Liszt
étiqueté « inventeur du
poème symphonique » tout comme Aloysius
Bertrand est étiqueté
« inventeur du poème en
prose ». Non que la gageure esthétique du
compositeur hongrois ne soit révolutionnaire : se
référer à
l’écrit, faire
comme l’écrit, sans l’écrit.
Mais c’était, justement, une gageure : ce
n’était
pas une évidence. Ce que l’on a
commencé par appeler les
« fantaisies pour
orchestre » étaient des œuvres
dont le titre
renvoyait explicitement à une œuvre
littéraire, de préférence monumentale,
dont le texte/livret auquel se référait chaque
partie musicale jouée au concert
était écrit sur un programme destiné
à l’auditeur. En effet, si Liszt fera de
sa Sonate en si mineur
dédiée à Robert Schumann -sonate qui
ne se
réclame d’aucune œuvre
littéraire- un programme implicite à part
entière dont
l’organisation a donné lieu aux travaux
d’analyse les plus poussés, pour Liszt
la musique à programme se réfère
à « une idée, un
argument, une succession de faits ou
d’état » et inversement:
musicalement, ce
dernier ou
cette dernière est réduite à
« une idée
conductrice » qui parcourt la
partition.[88]
Ce qui sauve Liszt de la tentation de l’imitation de ce qui est « dit » est sa volonté de prouver dans des œuvres purement sonores abouties, et donc forcément articulées, un possible pour la musique d’exprimer ce « sentiment poétique » du siècle romantique, notion très en vogue mais floue : or chez Liszt celle-ci est essentiellement épique et mise en scène un peu manichéenne (une scène sonore) de thèmes et motifs souvent très opposés afin qu’il soit possible à l’oreille d’en reconnaître l’affrontement. Du reste, ce côté épique et manichéen dans la lettre du texte symphonique lisztien est une préoccupation fondamentale et quelle que soit sa valeur « poétique »: fondamentale en ce qu’elle offre au piano pour lequel Liszt transcrit tout, et à tour de bras, des possibilité nouvelles d’expressions que le compositeur pousse à ses extrêmes. Cet amour de Liszt pour le piano, sa foi dans ses possibilités illimitées sont intrinsèques à la création du compositeur, viscéraux : en aucun cas, jamais, il ne s’agit de faire de l’épate dans les salons privés malgré le succès qui a un peu stigmatisé la musique du compositeur. Il s’agit bien de donner à l’instrument ses lettres de noblesse. La littérature (Dante, Goethe) avec ses univers foisonnants et spectaculaires ne sont pour Liszt de ce point de vue qu'un prétexte. On peut sans doute dire que les monuments issus, sinon au moins inspirés de la transcription d’œuvres (souvent des opéras) ont été le point de part d’une « littérature de la littérature » au bénéfice du répertoire pianistique. Cependant cette restriction, paradoxale, du « poétique » à son sens le plus large soit le moins signifiant de « sentiment poétique » n’a certes point été sans reproches, et on le comprend, de la part d’autres musiciens préoccupés par la notion esthétique de manière plus fine, et dans une perspective davantage littéraire qu’instrumentale : une préoccupation moins « littérale » d’une œuvre qui serait devenue devenue un livret puis d’un livret qui serait devenu un schéma… Sauf dans le dernier Liszt des Années de pèlerinage, plus profond et littéraire, dont les oeuvres n’ont pas besoin de programme adossé au texte musical puisque le compositeur y crée son propre rapport au monde et à sa mystique : et c’est encore un autre piano que nous fait découvrir Saint François d’Assise, le sermon aux oiseaux et Saint François d’Assises marchant sur les flots. S’éloignant de l’esthétique du premier poème symphonique descriptif, Liszt rejoint la poésie pure dans des oeuvres désormais purement pianistiques et non plus écrites pour un piano orchestral.
Avant Liszt déjà, d’autres genres d’œuvres composées spécifiquement pour piano ont traduit une poésie inspirée de sources littéraires (fantaisies, ballades issues de la ballade chantée). Cette volonté d’exprimer le « sentiment poétique » de manière spécifiquement pianistique passe par des genres musicaux aussi protéiformes que le poèmes symphonique. Il s’agit de la ballade, genre inédit avant Chopin qui a emprunté le terme à un poète et ami de ce dernier, l’écrivain Adam Mickiewicz. Le programme est plus expérimental qu’ambitieux, il ne s’appuie pas tant sur un texte en lui-même que sur des figures mythiques comme celui de l’Ondine de Mickiewicz qui aurait inspiré la 3ème Ballade de Chopin selon le pianiste Alfred Cortot. Pierre Brunel souligne cette dimension de l’évocation propre au genre musical pianistique inspiré de l’esthétique littéraire romantique :
« Au piano, la ballade ne raconte pas, elle cherche à raconter. »[89]
C’est pourquoi le mythe est une source d’inspiration assez souple et adaptable, comme les éléments de la nature, pour constituer un sujet de ballade ou de la fantaisie qui fleurit chez les compositeurs romantiques : la fantaisie de Schubert, Schumann, pour elle directement apparentée à son homonyme littéraire. Ainsi Christian Goubault parle de la
« dimension fantastique et légendaire [d’œuvres qui] font appel à l’imaginaire, au rêve, au fantastique. »[90]
Il rappelle que cette perméabilité des genres littéraires et musicaux (au point de s’inventer l’un par rapport à l’autre) vaut dans l’autre sens : ainsi les « rhapsodies » de Petrus Borel.
Chez Schumann, les « Fantasiestücke » sont la forme libre adoptée par le compositeur. Elles peuvent être également regroupées en cycles comme c’est le cas dans l’œuvre de Ravel : en tant que pièces indépendantes les unes des autres mais appartenant au même « cycle » programmatique, et surtout poétique en ce qu’il invite à la rêverie mais ne cherche pas à dépeindre :ainsi les Kreislariana op.16 (1838) qui se réfèrent directement à Hoffmann et l’étrangeté du personnage emblématique, l’artiste Kreisler duquel Schumann a été maintes fois rapproché. Les Waldszenen op.82 encore (1848-49), où « le « mystérieux » fait aussi bien partie des sphères privilégiées que le « sombre », le « solennel », tout comme le « menaçant », l’ « enjoué », et autant que le repli sur soi et le souvenir des temps révolus. La forêt est utilisée dans ce contexte comme l’une des métaphores privilégiées. Les sources littéraires dans ce cycle romantique sont utilisées de manière absolument particulière : les poèmes, contemporains, ont été choisis après la composition des différentes pièces, et Schumann voulait placer sur la page de titre une strophe entière de G. Pfarrius auquel il rattache plusieurs des Waldszenen dans un programme ouvert qui rappelle Nietzsche :
« Viens, quitte la clameur du marché, laisse la fumée qui s’assemble autour de toi/ t’enserre le cœur, et respire de nouveau librement. » :
la musique est elle-même le poème, elle est elle-même la forêt où fourmillent les « fleurs mystiques de la forêt enchantée musicale »[91].
Pour Schumann comme pour Chopin, Pierre Brunel parle de « poésie pure » : une poésie musicale. Les Kinderszenen font vivre également à l’auditeur la poésie du moment dans l’évocation de l’instant: l'instant du jeu, du sommeil qui vient. En marge de cette poésie volée à l'instant, sorte de voix narrative qui jusque là ne s’était jamais fait entendre, la dernière pièce s’appelle « der Dichter spricht » (le poète parle). Après des pièces aux rythmique aussi variées que leurs tempi diffèrent au sein d’une pièce, celle-ci, comme intemporelle, consiste en un choral aux accords simples et expressifs, avec de multiples retards qui font attendre les résolutions harmoniques parfois laissées suspendues... Le tempo est lent et sans cesse ralenti par des valeurs longues, de multiples points d’orgue lorsque, au centre de ce volet, la voix se fait entendre: récitatif a capella rasséréné par une seconde voix qui vient l’appuyer en canon puis c’est l’inverse, et cette page de poésie musicale qui semble exprimer la merveille de l’indicible se dilue après la reprise de son choral dans le silence… Eminemment littéraire, cette présence créatrice qui surgit comme pour considérer de l’extérieur l’œuvre écoulée avec sa conscience de « poète » et cependant toujours musique, est troublante.
Schumann est un créateur que Liszt admire, mais qui pour lui ne partage pas avec ce dernier une conception du piano similaire. Liszt est avant tout créateur pour le piano, défenseur du piano qui d'après lui doit être capable de transposer ce qui est écrit par ailleurs, alors que pour Schumann la musique traduit l’indicible, elle est une sorte de moyen pour l’âme, la Poésie elle-même, de s’incarner dans une matière sensible. En effet, l’idée de Schumann s’accorde avec des critiques de son temps comme Fétis, pour considérer, contrairement à la conception lisztienne de la musique à programme dont le but serait d’ égaler esthétiquement une œuvre de la littérature tant dans son approche descriptive que dans ses dimensions, que cette idée serait « la plus rétrécie qu’on puisse se faire de la destination de la musique, car cet art agit avec tant de puissance sur notre sensibilité que parce qu’il est essentiellement vague et indéterminé dans ses conditions. »[92]A la suite de cette conception d’ une indépendance de la musique par rapport à son sujet, Richard Strauss parlera pour ses œuvres orchestrales de Tendichtung (poème sonore ou musical) dont l’architecture « fixée par le programme » serait garante, même si Glenn Gould souligne malicieusement l'impossibilité d'identifier des liens tangibles entre le programme littéraire et l’œuvre en tant qu’objet purement musical qui s'en "inspire".
Héritier de ce carrefour de l’évolution du poème symphonique et de nouveaux possibles apportés par Liszt dans l’écriture des œuvres pour le piano, Maurice Ravel trouve sa propre voie esthétique en osant aborder de front et explicitement la question de la forme. Ainsi la référence au littéraire et au chorégraphique induit forcément chez Maurice Ravel une subversion du genre, et en cela constitue elle-même un enjeu esthétique sous les angles les plus divers. Car Ravel, ironiste, peut d’abord rendre hommage avec une respectueuse distance : ainsi le Tombeau de Couperin qui épouse la forme des suites de danses du 17ème siècle mais dont les harmonies parfois « jazzy » (Forlane) et le technique diabolique (Toccata) renouvellent la portée et évidemment abolissent la fonction. La toccata à l’origine était une pièce de début de concert faite pour se « mettre en doigts ». Or elle figure en dernière place du Tombeau, sa virtuosité digitale ( toutes en notes répétées staccato à la manière de Scarbo) rend en effet cette place nécessaire. Du reste le titre « tombeau » ne rend pas hommage qu’à Couperin : en effet, chaque pièce est dédiée à un ami disparu pendant la guerre, et c’est après la guerre en 1919 que Marguerite Long créera l’œuvre, salle Gaveau.
Ensuite, dans une œuvre comme à la manière de Chabrier Ravel, ironiste, met en abyme le pastiche de Chabrier lui-même qui s’en délectait : il procède à une citation[93] de Gounod avec une « fausse solennité dont l’Auvergnat (Ravel) savait parer ses malices. Mais l’harmonie dérape délicieusement, le rameau mélodique manque son but, s’orne dangereusement, ploie finalement pour tant tomber qu’il n’aboutit plus là où il faudrait. Un épilogue tentera de sauver la situation, reprenant la mélodie au début. Mais cette fois sans réussir à en tirer quoique ce soit… Avant d’avoir atteint les deux minutes, Ravel stoppe : l’académisme est sans avenir ! »[94]. Il y a aussi l’ironie revendiquée dans son titre comme dans la Sérénade grotesque, composée dès ses 18 ans, qui préfigure le grotesque mis en scène dans la dramaturgie pour piano d’Alborada del gracioso.
Enfin la technique pianistique elle-même est distanciée lorsque les circonstances ou les enjeux l’exigent. Le Concerto pour la main gauche s’il peut rappeler les 12 Etudes pour la main gauche composées par le porte-drapeau de la musique française académique du début du 20e siècle Camille Saint-Säens (et le titre fut peut-être choisi exprès, pour singulariser encore davantage sa démarche), est doublement provocateur. Il s’agit d’une œuvre de commande composée pour un mutilé de la Grande Guerre qui avait perdu un bras dans les massacres, alors que la Seconde Guerre se profilait à l’horizon… Il s’agissait bien entendu de développer une technique pianistique telle qu’elle « répare » symboliquement l’horreur infligée par la guerre, mais non de s’en tenir là pour Ravel qui, au-delà de la provocation, a créé pour cette « intimidante commande » une œuvre sublime prisée dans le monde entier qui fut chorégraphiée et jouée par des pianistes qui possèdent leurs deux mains… Marcel Marnat rappelle dans son article consacré à Maurice Ravel pour les 70 ans de sa disparition[95] qu’il y a encore 20 ans, l’histoire du Concerto pour la main gauche était inconnue du public.
Au-delà du clin d’œil très tentant et un peu facile aux Cinq doigts de la main, la démarche esthétique ironiste de Ravel qui se targue toujours d’un référent explicite dans son titre ou son sous-titre, et cependant est aboutie entièrement en tant qu'œuvre singulière, est manifestement très voisine de celle d’Aloysius Bertrand où le genre littéraire ne se rapporte pas tant à la métaphore du dessin et de la peinture, leurs sujets et leurs techniques, qu'il dépasse, mais se joue également de la musique en dépassant largement la comparaison convenue de la «lyre». La Sérénade fait titre. Ce n’est pas seulement la caricature d’une musique fausse mais tout ce à quoi elle renvoie dans sa mise en scène, dans son sujet : le littéraire se nourrit de la notion de genre musical. De la même manière, la Viole de Gamba consacre un poème à un seul son raté dont tout un monde surgit, un son qui dans le monde réel ne durerait pas même le temps de l’énonciation de la dernière phrase « la corde s’était cassée ». Ondine est structurée clairement grâce aux blancs, à la ponctuation, à l’anaphore, comme une ballade chantée enchâssée dans le récit. De la même manière, au-delà de ses démarches très particulières et plutôt engagées le compositeur manifeste ouvertement le souci essentiel de s’adapter à la réception des genres d’œuvres littéraires auxquelles il fait référence. Ainsi pour ma Mère l’Oye Ravel retient d’abord le timbre pianistique et des couleurs pour l’orchestration qui suivra (percussions, textures orchestrales) qui respectent l'intemporalité de cette musique créée d’après des Contes du 17e siècle. Et surtout il destine à l'enfance ces pièces d’abord jouées en concert par des enfants de ses amis, et avec une simplicité d’écriture telle que l’enfance s’y retrouve : « Le dessein d’évoquer dans ces pièces la poésie de l’enfance m’a naturellement conduit à simplifier ma manière et à dépouiller mon écriture ».[96]
Enfin il peut être utile, pour établir un véritable parallèle esthétique entre les deux artistes que sont le poète d’une part, le musicien d’autre part, de souligner que Ravel a adopté également la musique pour faire sens comme dans son Frontispice (1918), ce qui est une démarche rarissime en son temps: une musique d’accompagnement de la lecture d’un poème : « Trois accords finals mettent le comble à la surprise de l’auditeur par une brutale interrogation débouchant sur le vide. » Cette constante esthétique de Ravel dans le sens de l’adaptabilité au sens profond des œuvres qu’il met en musique s’applique à toutes, qu’elles soient symphoniques ou pour piano : d’ailleurs souvent ses œuvres ont le plus souvent d’abord été composées pour le piano (Ravel s’étonnait qu’on puisse composer sans piano) et ensuite seulement adaptées pour l'orchestre (Alborada, Habanera, Ma Mère l'Oye) sans doute à cause de l’atemporalité sonore du timbre du piano qui rend toute orientation possible.
Gaspard de la Nuit pour sa part n'a pas été transcrit pour orchestre alors que le triptyque a été composé en 1908- Ravel aurait donc pu y revenir. Mais comment orchestrer un « poème pour piano » ? Cette démarche seule est une contradiction, qui n’a cependant pas empêché les éditions Durand (premier éditeur de Ravel) de commander à Marius Constant une orchestration de Gaspard de la Nuit en 1990[97]. Cette version fut créée par Laurent Petit-Girard en 1991 puis Christoph Eschenbach en 2004. On peut être « pour » en vertu de l’hommage (qui a dû rapporter beaucoup à l’éditeur), et du rayonnement encore plus grand de l’œuvre qui, si elle n’a été jusqu’alors enregistrée que deux fois, est de plus en plus souvent jouée en concert. On peut aussi n’être pas « tout à fait pour » : car la clarinette d’Ondine sonne très « après-midi d’un faune »; il s’agit d’une orchestration bien « à la française » de celles que Ravel avait en horreur, lui qui s’exclamait à propos de Debussy que c’était un grand compositeur mais qu’il était décidément « dommage qu’il orchestre si mal ! » et préférait, de loin, les timbres orchestraux de Richard Strauss... Quant à la cloche choisie pour traduire son homologue incertain, la pédale de si bémol du Gibet, elle rend le questionnement du poème d’Aloysius Bertrand pourtant fondamental dans le texte, désormais inutile ! Le narrateur entend une cloche, voilà tout! Pas la peine d’en faire tout un poème… [98]
« …pour piano » : Liszt le Matador et Ravel l’Etrangleur
C’est sans doute ici que la référence plus spécifique à Liszt peut prendre tout son sens. D’abord (mais pas seulement) parce que Gaspard de la Nuit est reconnu pour être des plus redoutables d’exécution des œuvres de Ravel. Si la technique de Scarbo peut être apparentée à la Toccata du Tombeau de Couperin avec ses notes répétées, sa rythmique acérée et un tempo « d’enfer », Ondine met en œuvre une technique très ressemblante aux thèmes de Feux-follets, la 5ème des Etudes d’exécution transcendante de Liszt, mais surtout aux Jeux d’eau de la villa d’Este. Les poèmes Scarbo en particulier, ont été choisis dans un intention compositionnelle clairement revendiquée : celle de composer une œuvre pianistique « d’une virtuosité transcendantale, aussi difficile que l’Islamey de Balkirev » : Maurice Ravel ne se réfère donc pas directement aux études de Liszt malgré le titre des Etudes transcendantes de ce dernier (qui a pu faire oublier la référence explicite à Balakirev). Et cependant il existe bien un héritage lisztien dans Gaspard de la nuit. Peut-être cependant la filiation est-elle plus complexe, plus profonde que la simple revendication au virtuosisme que Liszt dépasse mais qui constitue son Kitsch des plus indécrottables…
« Qu’est-il
resté des agonisants du
Cambodge ?
Une grande photo
de la star
américaine tentant dans
ses bras un enfant jaune.
Qu’est-il
resté de Tomas ?
Une
inscription :
Il
voulait le royaume de Dieu
sur la terre.
Qu’est-il
resté de Beethoven ?
Un homme morose
à
l’invraisemblable crinière, qui
prononce d’une voix sombre : « Es
muss sein ! ».
[99]
Les portraits de Liszt montrent soit « Liszt à 25 ans », soit « Liszt à 70 ans ». Dans les deux cas il porte les cheveux longs et raides, un profil acéré : une seule chose diffère, les peintres de sa jeunesse ont opté pour le peindre avec les traits de la beauté, ceux de sa vieillesse l’ont enlaidi à loisir. Un fiction de sa venue telle qu’elle est présumée avoir eu lieu à Paris le montre, enfant surdoué et hystérique, se roulant aux pieds d’un directeur du Conservatoire inflexible, puis sautant de joie dans les bras de Monsieur Erard en l’embrassant après lui avoir joué un répertoire époustouflant: Erard lui promet son quatrième piano[100]. Liszt est le pianiste de la démesure. Lorsque Paganini vient donner ses concerts à Paris en 1831 Liszt écrira : « Quel homme ! Quel violon ! Quel artiste ! Quelle souffrance, quelle angoisse, quels tourments ces quatre cordes peuvent exprimer ! ». Aucun des pianistes qui se trouvent dans la salle n’en sortira indemne. Schumann utilise une machine (peut-être le chiroplaste de Logier) qui lui coûte un doigt resté paralysé. Quant à Liszt, il se rase la tête afin de ne pouvoir plus courir les réceptions mondaines et rester enfermé chez lui à travailler son piano. Quant à Chopin qui a sans doute entendu le virtuose à Varsovie en 1829, il lui dédie des variations connues sous le nom : Souvenir de Paganini.
Il est certain que le piano virtuose en tant que moyen de dépassement de soi est une particularité et une vocation précoce chez Franz Liszt. Quiconque entend les Fantaisies pour orchestre et transcrites pour piano peut appréhender combien cette écriture virtuose est nouvelle : piano orchestral de tous les possibles, et c’est dans l’exploration de ces derniers que Liszt se dépasse. Le piano romantique est l’instrument par excellence et le devient d’autant plus que d’œuvres sont créées mais aussi, pour beaucoup, transcrites par Liszt, souvent au détriment de l’idée littéraire ou du respect de l’esprit de l’œuvre originelle. Ce culte de l’instrument semble communicative chez des spécialistes du compositeurs et a fait l’objet d’une technique spécifique, d’une « école » où l’on parle « d’énergie tirante » que les doigts doivent manifester au clavier, au contraire de la projection digitale sur les touches du piano, et qu’il enseignait à ses élèves : « Clarck, un élève de Liszt, affirmait que celui-ci détestait les pianistes qui se penchaient en avant sur le touches et qu’il conseillait de reculer les corps pour reculer l’action pianistique, préconisant « des gestes de traction allant du couvercle du clavier vers le bord des touches »[101]. Je ne sais ce qu’aurait dit Liszt s’il avait regardé joué Glenn Gould, toujours est-il que les propos de Glenn Gould sur la musique manifestent une vocation de la musique, non du piano en tant que tel malgré une exigence… Au contraire, Glenn Gould assure que travailler des exercices fastidieux des heures durant n’est absolument pas obligatoire et peut-être même non souhaitable, et que l’idée poétique, une idée qui aide à surmonter la difficulté technique redoutée, permet de dépasser cette dernière sans problème: que la bonne attitude d'instrumentiste est plutôt là, dans cette sécurité mentale à penser de telle manière que la difficulté puisse être dépassée, n’ait plus lieu d’être, plutôt que de la forcer[102]. Il faut dire que Glenn Gould ne goûte pas Liszt. Il faut dire aussi que lorsqu’on lit les propos de Bertrand Ott, leur l’obscurité ne suffirait pas à motiver l'intérêt de la technique pour la technique : des phrases comme « La virtuosité comme incarnation artistique est souffle » ou encore « le mécanisme de Liszt se veut tellement plus vaste, plus universel que les émotion de notre « ego », qu’il tend la main vers un magnétisme environnant », voire « [le mécanisme lisztien] incite à jouer comme si nous étions un résonateur de l’Univers »... La dérive sectaire n’est pas loin, et abouti le Kitsch de Liszt-la-paluche qui étreint son piano comme un cow-boy ou un amant de film X :
« Liszt prend corps à corps le clavier, le dompte, lutte avec lui, l’étreint, le magnétise de ses mains puissantes »[103].
Marcel Marnat appelle d’ailleurs « le piano violé » le piano détourné de sa fonction sonore : non pas tant par rapport à Liszt lui-même lorsqu’il se dispense de « l’effet de manche », et dont il reconnaît les apports des dernières œuvres notamment par rapport à Maurice Ravel, mais par rapport à un John Cage qui place des objets métalliques et des punaises dans le mécanisme d’un piano à queue qu’il abîme le temps d’un concert et nomme « le piano préparé », ou encore une démarche tout de même proche de la démarche lisztienne en ce qu’elle préfigure le piano orchestral : celle de Beethoven (même si les opus 109 et 110 des Sonates pour piano de ce dernier n’ont rien de symphonique).
Du reste, l’auteur de Bertrand Ott donne lui-même les arguments multiples que l’on pourrait opposer à une telle utilisation du piano dont ceux-ci :
-« les pianos de Liszt étaient plus légers que nos pianos contemporains »
Ce qui est vrai, et d’autant plus intéressant que Maurice Ravel était attiré par ces sonorités plus légères et perlées des piano Erard que par les Steinway ou Bösendorfer.
-« Voyons ! Il n’y a pas de technique meilleure qu’une autre ; laissons donc faire la nature, puisque chaque pianiste a des mains différentes, ce qui entraîne une adaptation personnelle au clavier ! »
Mais oui, cela est vrai aussi, d’autant plus que la technique pianistique de Maurice Ravel tenait aussi d’une physiologie particulière (puisqu’il s’agit de mettre en lumière le piano de Ravel en regard de l’héritage, ou plutôt de la partie d’héritage lisztien). Ses amis taquinaient Ravel à propos de ses « mains d’étrangleur ». Des mains petites qui n’encourageaient pas, par exemple, les montées et sauts d’octaves que l’on trouve chez le compositeur hongrois. Des pouces largement séparés des autres doigts de la main, ce qui permettait à ce doigt souvent un peu lourd chez les pianistes davantage de mobilité. Une harmonie originale et sévèrement pensée qui cependant trouvait forcément à l’heure de la composition, puisque Ravel composait au piano, des directions régies par un geste auquel Ravel, très bon pianiste, était familier : d’où une technique digitale particulière qui lui convenait parfaitement et assimilait quartes et quintes inédites, ce qui ne convenait pas forcément aux habitudes prises très tôt, de ses amis pianistes. D’aucuns ont relevé ce « naturel » avec laquelle les harmonies lisztiennes se plaçaient facilement sous les doigts, rendues difficiles d’exécution seulement par l’abondance de difficultés qui appartiennent cependant aussi au répertoire de Chopin par exemple (mais que celui-ci rend consubstantiel de l’œuvre qu’il poétise dans une musique efficace où tout est expression, et non expressivité). Mais chez Liszt l'amplitude du geste frise parfois « l’effet de manche » dont parle Marnat. Ainsi dans la technique de Ravel « l’achoppement du pouce » de la main gauche qui vient souvent passer sous la main droite tandis que celle-ci tricote par-dessus est typique, comme dans Ondine. Il y a également chez Ravel tous ces procédés rendus possibles par l’utilisation des gammes pentatoniques des gamelans, par exemple, avec de grands glissandos sur les touches noires comme dans Jeux d’eau, et du coup (après tout, pourquoi pas !) les glissandos sur les touches blanches qui donnent de bonnes ampoules aux doigts. Le geste participe donc d’une esthétique.
Certes, comparer la technique ravélienne et la technique lisztienne ne se défend pas facilement dans deux écritures assumées de part et d’autre, deux démarches absolument distinctes dans l’approche de l’instrument : Ravel aimant à rêvasser sur les vieux pianos désaccordés aux sons de cloches un peu faux, un peu fêlés qui hantent son œuvre comme les clochers celle d’Aloysius Bertrand, tandis que Liszt rêve d’un piano symphonique. Le point où les deux compositeurs semblent se rencontrer semble être dans la stylisation de mouvements rapides de notes à travers la notion de fluidité : ainsi Ondine de ce point de vue hérite des Jeux d’eau de la Villa d’Este, ou encore de Saint François d’Assises marchant sur les flots dans le déplacement de masses aquatiques plus denses : le premier thème de Scarbo, même s’il n’est pas dans « l’esprit de l’eau », soulève des masses de sombre qu’évoquaient déjà les remous de Saint Francois... On a de la même manière comparé les Feux follets, 5ème des Etudes d’exécution transcendante aux séquences les plus mobiles, toutes en chromatisme, de Scarbo qui sourdit dans l’ombre.
Or la musique de Ravel semble plutôt correspondre au propos suivant de Marcel Paquet à propos de la musique de Liszt :
« (…) il reste que ses références, qu’elles soient naturelles, poétiques, ou encore picturales, n’agissent nullement à la manière d’un donné pré-conceptualisé, mais plutôt en raison du mystère qu’elles contiennent, en raison de l’ouverture au sensible qu’elles-mêmes sont déjà. » [104]
Cette idée est très importante dans la mesure où elle ouvre la réflexion à deux notions qu’il faut relever pour sortir Liszt du carcan de virtuose dans lequel il est volontiers enfermé : d’une part la notion d’improvisation ou d’approche approximative qu’il permet à ses volutes sonores, d’autre part l’importance du geste instrumental sans qu’il soit question de le théoriser ou d’en faire une essence créatrice chez Liszt ou chez Ravel. Avant de développer ce double aspect peut-être commun aux deux compositeurs, « la manière de » du sous-titre de Gaspard de la nuit peut être relevé : car Marcel Paquet conclut de son propos que: « La circulation entre ces trois arts (peinture, puisque, poésie) n’est pas concevable comme totalité achevée ou domination de l’un sur les autres, mais sans cesse comme ouverture ouverte. C’est cela, le romantisme. »
La stylisation
Point de rencontre et point d’accroche, la stylisation existe d’une manière parfois remarquablement similaire chez les deux compositeurs : sous la double égide de l’improvisation ou de son avatar savant, l’ « approximation » écrite, ainsi que du geste instrumental.
Le sentiment de l’improvisation naît d’abord du foisonnement à l’intérieur de textures denses et riches, d'ailleurs visibles à l’œil nu sur l’espace de la partition. Sur la partition des Jeux d’eau de la villa d’Este le trille de doubles notes en triples croches à droite est doublé à la main gauche : quand au thème qui occupe la voix du dessous, comme dans Ondine où il est plus facilement identifiable car il occupe à lui seul la seconde portée, il consiste dans les croches plus espacées de la voix de basse. Pour Michaël Levinas cette « phrase mélodique jouée à la main gauche est comme amplifiée par le jeu des résonances harmoniques des trémolos et des trilles. Le trille devient une sorte de vibration. Trilles et trémolos ont la même fonction et se rejoignent dans un même mode de jeu : entretenir cette même « vibration harmonique » inspirée des bruits de l’eau dans les loggias du jardin de Tivoli. » [105]

Cette approximation sonore, « vibratoire » rendue par la densité et la dissonance (puisque la résonance de ces notes séparées par un intervalle minime est fondu dans la pédale) peut-être rapprochée du thème d’Ondine :

On reconnaît en effet la texture de triples croches et le thème en croches à la main gauche : « sempre legato » (très lié) chez Liszt et de la presque même manière qui appelle un jeu « très expressif » chez Ravel: « dolce, tranquillo » chez Liszt / « très doux » chez Ravel.
Sont remarquables également les tonalités respectives des deux oeuvres(fa#Majeur avec six# à la clef pour les Jeux d’eau de la villa d’Este, et do#Majeur avec sept dans Ondine), la seule différence étant l’irrégularité des trémolos d’Ondine dans l’alternance de la note la plus aiguë « la » qui tintinnabule de manière irrégulière par rapport à l’accord avec lequel elle est alternée, ce qui n’est pas le cas dans les Jeux d’eau de la villa d’Este lisztiens qui utilisent, du coup, un procédé de notation simplifié : les têtes de notes en blanches alors que les hampes sont bien celles de triples croches (voir plus haut).
De ce point de vue Ondine semble plus proche encore des Jeux d'eau de la villa d'Este que les Jeux d’eau de Ravel (1901), même si le titre de cette dernière pièce pianistique évoque davantage le titre lisztien. L’œuvre des Jeux d’eau de Ravel est antérieure et déjà très moderne, très particulière dans sa manière de représentation sonore de l’élément liquide: ce pourquoi sans doute les deux « jeux d’eau » sont si souvent comparés. Elle manifeste toutefois une écriture différente et davantage debussyste (arpèges et mesure, malgré le glissando central précédé de l’indication d’accelerando). D'autre part ses thèmes (ci-dessous, le premier thème) consistent eux-mêmes dans l’évocation liquide. Il s’agit d’une démarche d’écriture assez différente et où la notion de « texture » est moins évidente, à l’oreille comme à la contemplation de la partition où les intervalles entre les notes sont visiblement plus importants :

La stylisation du mouvement dans Scarbo est également intéressante à comparer avec l’écriture d’un programme littéraire voisin chez Liszt en regard d’une autre texture, toute en griffures, notes acérées et déplacements sur le clavier dans toutes les tessitures (cf analyse de Scarbo plus haut). Scarbo en effet « se situe dans la tradition du « gnomus » et autres boiteux et nabots sauteurs chers à la musique à programme (…) ici, toutes les possibilités « pantomimiques » de la musique sont déployées (…) faisant du personnage-piano un pantin bavard et désarticulé »[106].
Dans Scarbo les notes répétées et ressérées en doubles croches sont à rapprocher du début de la Méphistowaltze de Liszt: avec un thème à proprement parler, un vrai thème en notes staccato dans les graves (en clef de fa) :

Les manifestations démoniaques de la figure de Scarbo d’une part, de celle de Méphistophélès d’autre part, ces deux personnages vecteurs de mort, sont mis en présence dans un registre dynamique et « ludique » selon Pierre Brunel, assimilable selon Michel Guiomar[107] à la catégorie du Divertissement: « l’expression de la Mort dans l’art étant contrainte à des masques, des compromis, des refus même où nous retrouvons la tendance majeure du Divertissement ». En effet, le divertissement, le « scherzo », sont dans ces deux œuvres contaminées par le sombre et le déchaînement (thème 1 de Scarbo) qui prennent la forme de montées arpégées dans Liszt dans un souci de transmission poétique, pour le coup, proche de la simple transcription. Un équilibre palpable est donc mis en œuvre entre la notion de divertissement et l’écriture de la hantise qui rend la référence ambiguë. Inversement, on peut observer une autre texture possible dont l’esthétique est celle du pur divertissement chez Liszt: il s'agit de celle de son Gnomenreigen issu des Etudes de concert. La mort en est clairement absente, comme cela est visible à l’œil nu également.

Il s’agit de petite notes avec appoggiatures dans les aiguës (remarquez les deux clefs de sol) : ce scherzo n’a rien de subversif puisque sa rythmique est respectée par ces croches mobiles et légères. Il existe donc bien une esthétique de la stylisation chez Ravel qui peut être rapprochée d’une prédisposition très originale de la notion de texture thématique de Liszt au sein de sa musique écrite pour piano (il ne s’agit pas ici de transcriptions). Cette attitude esthétique est indissociable d’une technique pianistique particulière, soit du geste instrumental.
Une
seconde
dimension stylistique consiste dans la velléité
de l’improvisation, ou de
l’impression d’improvisation, rendue certes par ce
geste musical spécifique aux
différentes textures qui traduisent un univers particulier,
apparemment commun à
Liszt dans certaines de ses œuvres, et Ravel dans Gaspard
de la nuit :
ainsi la multiplicité des points d’orgue dans Scarbo :![]() Ce temps
ajouté à la valeur de la note ou à
l’espace entre deux notes correspond, en
théorie, à « la valeur et
demie » de la note à laquelle il se
réfère : en
vérité sa longueur est à
l’appréciation de
l’interprète. Il
constitue en effet une partie de temps non mesurée entre
deux parties du
discours et de la dramaturgie musicale, mais permet
également de s’attarder,
encore un peu, sur la partie qu’il clôt. Dans Ondine
ce jeu de temps
non mesuré mais resserré ou
étiré, est mis en œuvre par des groupes
rythmiques
inédits sensés prendre place de
manière égale dans le temps (au sens
d’unité de
mesure : une noire par exemple) qui le comprend, avec toutes
les
possibilité d’accélération
ou
de ralenti que le pianiste peut
intégrer à son
interprétation :
Ce temps
ajouté à la valeur de la note ou à
l’espace entre deux notes correspond, en
théorie, à « la valeur et
demie » de la note à laquelle il se
réfère : en
vérité sa longueur est à
l’appréciation de
l’interprète. Il
constitue en effet une partie de temps non mesurée entre
deux parties du
discours et de la dramaturgie musicale, mais permet
également de s’attarder,
encore un peu, sur la partie qu’il clôt. Dans Ondine
ce jeu de temps
non mesuré mais resserré ou
étiré, est mis en œuvre par des groupes
rythmiques
inédits sensés prendre place de
manière égale dans le temps (au sens
d’unité de
mesure : une noire par exemple) qui le comprend, avec toutes
les
possibilité d’accélération
ou
de ralenti que le pianiste peut
intégrer à son
interprétation :

Les deux premièrs groupes de triples croches comptent respectivement 5 et 6 notes, puis un groupe de 13, etc… Les rythmes mesurés de la portée en-dessous seuls pemettent de se repérer. Parfois, sans doute pour indiquer une nécessité d’accélération ou plutôt de resserrement (car le tempo est indiqué comme devant être constant) Ravel indique lui-même le nombre de notes contenues dans les groupes :

Enfin les changements de mesure sont incessants dans Ondine de Ravel : il y en a 36 en tout, parfois d’une mesure à l’autre. Ils rendent impossible la sensation d’une carrure. Et cette impossibilité, cette fluctuation structurelle du rythme est appuyée par des changements de tempo récurrents et livrés, eux aussi à l’appréciation de l’interprète : « cédez légèrement », « un peu retenu »,« au mouvement », « Retenez », « un peu plus lent », « retenez », « encore plus lent », etc… Ainsi consiste le paradoxe d’une approximation liée au geste et à la notion qui suppose une écriture de l’imprécis et qui est le propre de l’intégrité de la texture musicale fluide, telle qu'elle est mise en oeuvre par la stylisation de l’élément aquatique chez Maurice Ravel. La fluctuation est une dimension assez importante dans l’écriture et la perception sonore pour qu’il semble nécessaire de distinguer cette stylisation particulière, du « brouillard », pour lui plutôt debussyste (et orchestral chez ce dernier) à laquelle Cécile Reynaud la compare[108], et ce d’autant qu’elle met de côté le geste virtuose qui est partie prenante de l’esthétique ravélienne et que Jankélévitch assimile à « une situation instable, fluctuante, et irréductible aux concepts. »
Chez Liszt la propension de l’écriture à l’improvisation est également mise en valeur par Michaël Levinas[109]qui parle d’abord en effet, comme nous parlons de texture, de « timbre –virtuosité ». La « matière foisonnante » que souhaitait Aloysius Bertrand pour l’illustration de ses poèmes est servie chez Liszt par « une autre utilisation des notes, des inflexions et des phrasés ». Il ajoute que « tout cela n’était pas de l’imprécision » mais un choix esthétique : choisira-t-on en effet de chanter, ou plutôt de styliser ? Ainsi le « spectre harmonique » a-t-il dans les oeuvres "liquides" plus d’importance que l’énoncé. Levinas y voit les marques de Liszt interprète de ses œuvres dont parfois en effet les notations servaient de memento à partir desquelles Liszt improvisait. Il conclut son article sur ces mots : « C’est en cela sans doute que la virtuosité « lisztienne » et les Jeux d’eau de la villa d’Este ont exercé une telle influence sur l’impressionnisme de Ravel et Debussy ». Pour préciser cette notion d’ « impressionnisme » dans le sens qui nous intéresse et que nous avons développé, il est possible de se reporter au remarquable article de Christian Goubault[110].
Poursuivre la réflexion :
la musique et le poème qui l’inspire…
Pour Betsy Jolas, compositrice, la stylisation est essentielle car elle permet le passage d’un langage (les mots) à un autre (la musique). Certes, il existe vraisemblablement une complexité et même, autant le dire : une béance, entre les deux arts de la poésie et de la musique qui font « poème » : l’œuvre musicale inspirée par un texte, mais encore un texte qui stimule les aspirations intrinsèques d’un compositeur dont l’esthétique est en soi éminemment inspirée du littéraire dans tout son cheminement, et aboutie en tant que telle. Il est remarquable de constater combien, d’ Aloysius Bertrand à Maurice Ravel, cette béance est encore soulignée par le choix d’une mise en musique de trois poèmes sans leurs mots.
En cela Ravel n’est l’héritier d’aucun autre et a quitté avec son Gaspard de la nuit les sphères lisztiennes de la transcription, en dépassant la question d’une hypothétique transposition des arts et d’une improbable perméabilité de l’un à l’autre, qui faisaient rêver à la fin du romantisme à un art « total » prôné et mis en scène par Wagner.
Le début du 20ème siècle, c’est l’agonie du langage tonal auquel repousser les limites ne suffit plus. C’est le reproche des grandes architectures musicales et parmi elles, du poème symphonique. L’histoire de la musique, surtout dans un tel contexte, serait impuissante à expliquer comment la rencontre de Maurice Ravel et Aloysius Bertrand a pu donner une œuvre qui appartient au grand répertoire de la musique pianistique de notre temps, et ce avec constance depuis sa création en 1909. Sans doute les sensibilités créatrices ne se targuent-elles pas des impossibilités de ce monde.
La compositrice Betsy Jolas parle de son expérience de mise en musique, en 1928, d’un poème de Pierre Reverdy auquel elle écrivit son l’inquiétude d’avoir, peut-être, trahi son texte. Reverdy lui répondit en ces termes:
« C’est le poème comme chose, comme réalité nouvelle dans le domaine des chose sensibles. Par conséquent tout ce qui peut partir de là, être ému par cette réalité neuve n’a qu’à devenir, à être à son tour une nouvelle chose, une nouvelle réalité à son tour émouvante et ainsi de suite. Le poète déforme et trahit tout ce dont il se sert pour s’exprimer, tout ce dont il part -le musicien aussi sans doute- . C’est-à-dire que ce qui compte dans une musique partie d’un poème -d’une émotion ressentie à la lecture d’un poème- c’est la musique et la puissance d’émotion qu’à son tour elle recèle. » [111]
par Marion Pécher.
Notes :
[1]En ce numéro du mois d’avril la revue Diapason consacrait un grand article à Maurice Ravel dont cette année célèbre l’anniversaire des 70 ans de sa disparition.
[2] Francis Mizio
[3] Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, Paris, 1993, p.258
[4] Valentine Hugo, « Trois souvenirs sur Ravel » in revue musicale, 1952, Ibid. p. 109
[5]Marcel Marnat, op. cit., p.125
[6] Roy Howat, « Debussy et le piano » in Claude Debussy, Van Dieren pour Radio-France, Cahors 1999, p. 41
[7] Riccardo Viñes raconte comment au Prélude de Tristan, il a vu Ravel, qui pour lui ne se prononcera pas sur le phénomène Mahler, pleurer …
[8] La passacaille procède en une basse obstinée au-dessus de laquelle varie un thème. La passacaille date de la Renaissance, et a été redécouverte grâce à J. Brahms à la fin du 19e. Il va de soi que la musique atonale redécouvre ces structures dans lesquelles elle met en œuvre de nouveaux langages.
[9] Alban Berg, Sieben frühe Lieder, Ane Sofie von Otter, soprano/Claudio Abbado, Wiener Philarmoniker, Deutsche Grammophon, Hamburg, 1993
[10] Pierre Boulez, entretiens avec François Lafon « Boulez fait son Mahler », le Monde de la Musique n°324, Octobre 2007, p.56
[11] Glenn Gould, le Dernier puritain, Fayard, 1984, p. 182-188
[12] Jean-Noël von der Weid, la Musique du XXe siècle, éd. Pluriel, 1997, p.19
[13] Maxime Joos, « Claude Debussy et Henri Dutilleux » in Claude Debussy, op. cit., p. 67
[14] La pédale au sens musicologique du terme constitue un procédé qui consiste à répéter à la manière d’un « continuo » ou encore d’un « ostinato » : une note, un accord, lors même que l’harmonie qui se développe parallèlement change, module. Ce procédé stylistique par excellence induit forcément un climat de tension, en tous cas une attraction sonore irrésistible par son omniprésence.
[15] A capella : sans accompagnement.
[16] Armure : altérations présentes à la clef, qui déterminent la tonalité
[17] pianisme : termes employés par nombre de critiques de Ravel dont l’écriture musicale s’inspire absolument des possibilités de la technique pianistique et qui, loin de constituer une virtuosité superficielle pour faire briller l’interprète, participe de l’œuvre: il s’agit bien d’une virtuosité signifiante.
[18] René Tranchefort, Guide de la musique de piano, Fayard, 1995, p. 314.
[19] Pierre Brunel, Basso Continuo, ed. PUF, Paris, 2001, p. 127
[20] Guy Sacre, la Musique de piano, ed. Laffond, colle. « Bouquins », 1998, art. « Ravel » p. 2216
[21] Ce qui est effectué dans la dernière partie de la présente étude : « poèmes pour piano »
[22] Ravel cité par Marcel Marnat, Maurice Ravel, ed. Laffont, 1993 ; p.118
[23] Marcel Marnat, op. cit., p.119
[24] je souligne
[25] Maurice Marnat, op. cit., p.171
[26] Pierre Brunel, op. cit., p. 135
[27] René Tranchefort, op. cit.
[28] Guy Sacre, op.cit., p. 2216
[29] Ibid.
[30] Cécile Reynaud, « Gaspard de la nuit, fantaisies à la manière de Ravel » in les Diableries de la nuit par F. Claudon, Presses universitaires des Dijon, 1993
[31] tierce picarde : un passage en mineur se voit, dans son accord parfait de tonique, qui le termine, agrémenté d’une altération qui rend majeure la tierce qui notamment le compose : il s’agit d’un pur effet, presque d’une convention de solennité chez JS Bach notamment.
[32] Aloysius Bertrand, Œuvres complètes, édition Champion, 2005, notes sur « Ondine »
[33] Cécile Reynaud, op. cit.
[34] Maurice Ravel, Ondine, édition séparée, aux éditions Durand
[35] Hélène Jourdan-Morhange, Ravel d’après Ravel, 1957 ; citée par M. Marnat, op. cit.
[36] Ibid., p.129
[37] Helen Hart Poggenburg, op. cit., p. 326
[38] Pierre Brunel, op.cit., p. 129
[39] Ibid., p.130
[40] Ravel plays Ravel,ed. dal Segno (www.dal-segno.com ).
[41] La partition peut être trouvée sur le net, notamment le site http://www.sheetmusicarchive.net
[42] Merci au site http://aboudet.chez-alice.fr/doc_musique/Modes_defile.html qui m’a rendu cette petite analyse possible et offre un panorama complet sur les modes existants (échelles de sons d’ailleurs et d’autres temps utilisées par nombres de compositeurs et permettent de s’éloigner des échelles classiques des tonalités majeures mineures qui structurent la musique baroque/classique/romantique, qui elle élargit le panorama expressif en utilisant plutôt les tensions du chromatisme.
[44] La forme lied est la forme : ABA’ .
[45] Aloysius Bertrand, Œuvres complètes par Helen Hart Poggenburg, ed. Honoré Champion, 2005
[46] Michel Guiomar, Principes d’un esthétique de la mort, ed. le Livre de Poche, coll. Biblio Essais, Paris, 1993 : p.189.
[47] Ibid., p. 207
[48] Ibid., p. 209
[49] Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 1993
[50] dissonance : frottement de sons dont les degrés sont très proches (ton ou demi-ton).
[51] On peut d’ailleurs remarquer cette indifférenciation du pleur et du rire qui se suivent et semblent se superposer chez Maribas, comme dans Ondine (où le mineur et le majeur se superposent en dissonance dans l’œuvre de Ravel).
[52] Pierre Brunel, op.cit., p.133
[53] Livre premier des fantaisies de Gaspard
[54] Marcel Marnat, op. cit., p.253
[55] La pédale de gauche du piano, qui guide les marteaux sur une seule corde, « una corda » : d’où un son plus sec plus sourd, comme l’est le pendu, désormais, « à la fanfare de hallalis ».
[56] expression propre à Marcel Marnat à propos d’autres œuvres de Maurice Ravel
[57] De ce point de vue, on peut déjà regretter la transcription, demandée par les éditions Durand, auprès de Maurice Constant en 1990 : la pédale de si bémol devient tout bêtement une cloche, ce qui plaît car l’effet est sensationnel avec une intentionnalité telle pour ne pas dire « sensas »: mais amoindrit la portée crépusculaire du texte de Ravel, qui pour elle questionne le non-dit autant que s’interroge le narrateur du poème d’Aloysius Bertrand. Ainsi « C’est la cloche qui tinte au murs d’une ville sous l’horizon, et la carcasse d’un pendu que rougit le soleil couchant » est-elle tautologique, du point de vue de la perception sensorielle : entend-t-on « la carcasse d’un pendu que rougit le soleil couchant ? ». Réduire la question « ce que j’entends, serait-ce… » par un tintement de cloche, voilà qui « plombe », sinon l’ambiance déjà plombée, du moins cette incertitude, structurante, essentielle au « poème » de Ravel et où se conjuguent le réel et le fantasme (qui est peut-être, pour lui, un autre réel)…
[58] Aloysius Bertrand, Œuvres complètes, p. 367
[59]à propos de « mouvement contraire » : la partie de main gauche descend et la main droite monte, ou le contraire. Ici, il s’agit du contraire.
[60] Vladimir Jankélévitch in Ravel, ed. du Seuil,1956, cité par Marcel Marnat, op. cit., p.136
[61] Propre à la gamme mineure, la note sensible est par définition le 7e « degré « (ou note) de la gamme, réhaussée d’un demi-ton, ce qui crée une échelle de langage plus étirée entre 6e et 7e degré, et amène une résolution plus laconique sur la tonique (8edegré qui constitue également le 1e degré de la gamme à l’octave supérieure)
[62] enregistré chez Ermitage, 1990, ERM 104 ADD
[63] Pierre Brunel, op. cit., p.137
[64] Marcel Marnat : pour les 70 ans de la mort de Ravel, Marcel Marnat a consacré un grand article que le compositeur dans la revue Diapason de Avril 2007. On peut trouver, nous indique-t-il, l’enregistrement sur piano mécanique dans le CD « Ravel plays Ravel » aux éditions Dal Segno (www. dal-segno.com).
[65] cf partition
[66] encore une fois au sens musicologique du terme
[67] « Maurice Ravel Complete piano works », par Jean-Efflam Bavouzet, Dabringhaus und Grimm, DDD, 2003
[68] Etienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique,
[69] Gérard Dessons, « le rythme et les arts : les ressorts d’une arnaque », in le Même et l’autre, rencontres sur la correspondance des arts, ss la direction de Parie-Hélène popelard, ed. de l’ Atelier des brisants, Mont-de-Marsan, 2003 , p.107
[70] Surnom qui les enchanta lorsqu’ils bousculèrent un soir de concert un monsieur qui leur cria « Eh, attention les Apaches ! »
[71] Riccardo Riera a initié son élève des années durant au répertoire notamment de la musique espagnole et semble avoir suffisamment compté pour que Maurice Ravel lui soit toujours resté fidèle, et lui envoyât en 1921 trois places pour aller voir son Heure espagnole.
[72] Maurice Ravel, Bolero…, Claudio Abbado & Orchestre Philarmonique de Londres, Deutsche Grammophon, Londres, 1985, 415 972-2 DDD, livret d’introduction.
[73] Maurice Ravel, Ondine, édition séparée, Durand, 1909, p. 6 mesure 6.
[74] une note staccato est une note « piquée », ce qui donne dans ce passage à l’accord et ornement en question un caractère percussif, et avec l’alternance des deux mains « jeté » comme négligemment autour de la mélodie, ce que met évidemment en valeur l’interprétation.
[75] Noctuelles est la 1ère pièce de Miroirs. Se succèdent ensuite Oiseaux tristes, une Barque sur l’océan, Alborada del gracioso et enfin la Vallée des cloches.
[76] L’opéra de Moussorgski arrangé par Rimski-Korsakov avait bouleversé le public parisien qui se surprit à pleurer la mort du héros assassin…
[77] Marcel Marnat, op. cit., p.251
[78] Pierre Brunel, Basso Continuo, ed. PUF, Paris, 2001, p. 127
[79] Michel Guiomar, Principes d’un esthétique de la mort, ed. le Livre de Poche, coll. Biblio Essais, Paris, 1993 : p.189.
[80] Trémolo : cf alternance serrée de deux notes ou accords des uns aux autres plusieurs fois : cf mesure d’Ondine reproduite sur cette page.
[81] Aloysius Bertrand, Œuvres complètes par Helen Hart Poggenburg, ed. Champion, Paris 2005, note p. 367
[82] Pierre Brunel, op. cit., p. 144
[83] René Tranchefort, la Musique de piano, ed. Fayard, 1993
[84] le Nain
[85] sur le site Youtube l’enregistrement est disponible : http://fr.youtube.com/user/Hofman1895 . Divers enregistrements par différents pianistes des trois pièces de Gaspard peuvent y être visualisées gratuitement
[86] c’est-à-dire sur des valeurs de notes plus longues, qui élargissent le discours mélodique
[87] Maurice Ravel, Complete piano works, par Jean-Efflam Bavouzet, chez MDG 604 1190-2, Germany 2003
[88] Christian Goubault, Vocabulaire de la musique romantique, éd. Minerve, 1997
[89] Pierre, Brunel, Aimer Chopin, PUF, 1999, p.137
[90] Christian Goubault, op.cit., article « fantaisie »
[91]citation issue de l’article du Berliner Musikzeitung Echo du 5 Janvier 1851, cité in Robert Schumann, Waldszenen op.82, ed. Henle Verlag, Préface par Ernst Herttrich, p. VIII
[92] Fétis, dans la Revue musicale de Paris du 1er Février 1836, cité in Christian Goubault, op. cit., « le poème symphonique » p. 154
[93] Utilisée dans beaucoup de symphonies du début du 20ème siècle notamment, qu’il s’agisse de « Frère Jacques » dans Mahler, d’un thème de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, ce procédé est l’équivalent de son homonyme littéraire
[94] Marcel Marnat, Maurice Ravel, ed. Fayard, Millau, 2006, p. 351-352
[95] Marcel Marnat, Maurice Ravel, in Diapason du mois d’avril 2007. pour les 70 ans de la mort du compositeur.
[96] Ibid., p. 610, Ravel cité dans son Esquisse biographique.
[97] Le lien suivant devrait vous amener à une présentation du projet orchestral : http://web1.radio-france.fr/chaines/orchestres/journal/oeuvre/fiche.php?oeuv=135000036
[98] Cette page permet d’entendre le début de chacune des trois pièces de Gaspard de la nuit dans leur version orchertrale : http://www.amazon.fr/Ravel-Orchestral-Versions-Gaspard-Couperin/dp/B00068B8PW
[99] Milan Kundera, l’Insoutenable légèreté de l’être, ed. Folio, 1990, VI, 29
[100] Iesolt Hazsanyi, « Rhapsodie hongroise » in Liszt, Silence n°3, Vesoul, 1986, p.249
[101] Bertrand Ott, « un Clavier de rupture », op. cit., p. 85
[102] Bruno Monsaingeon, Glenn Gould au-delà du temps, Ideal Audience, 2006 (DVD)
[103] op. cit.., in le Courrier de la Gironde, 1844.
[104] Marcel Paquet, « le romantisme comme au-delà des horizons accoutumés », in Silences, op. cit., p.99
[105] Michaël Levinas, « Thriller à la villa d’Este », Ibid., p.159
[106] Michel Chion, le Poème symphonique et la musique à programme, Fayard, Paris, 1993
[107] Michel Guiomar, Principes d’une esthétique de la mort, ed. Livre de poche, coll. Biblio essais, Paris, 1993
[108] Cécile Reynaud, « Gaspard de la nuit : Fantaisies à la manière de Ravel » in Francis Claudon, les Diableries de la Nuit, ed. des Presses Universitaires de Dijon, 1993.
[109] Michael Levinas, « Thriller de la villa dEste » in Silences, op. cit. , p.160
[110] Christian Goubault, « Source d’inspiration musicale » : http://www.cndp.fr/revueTDC/756-41008.htm
[111]Pierre Reverdy, cité par Betsy Jolas, « le rôle des relations musique-poésie dans la composition musicale, le Même et l’autre, rencontres sur la Correspondance des arts, dir. Marie-Héléne Popelard, ed. Atelier des Brisants, 2003, p.140-141